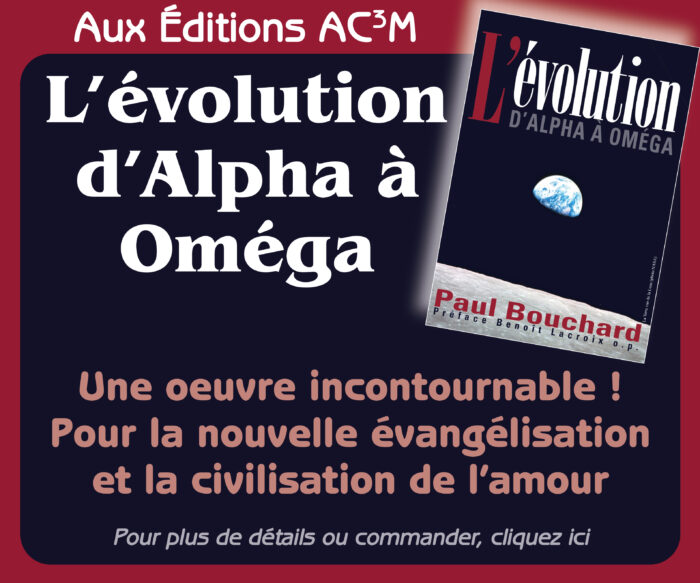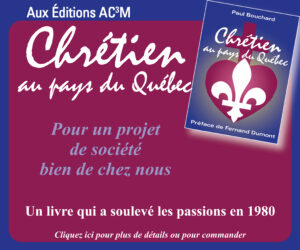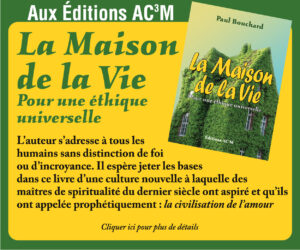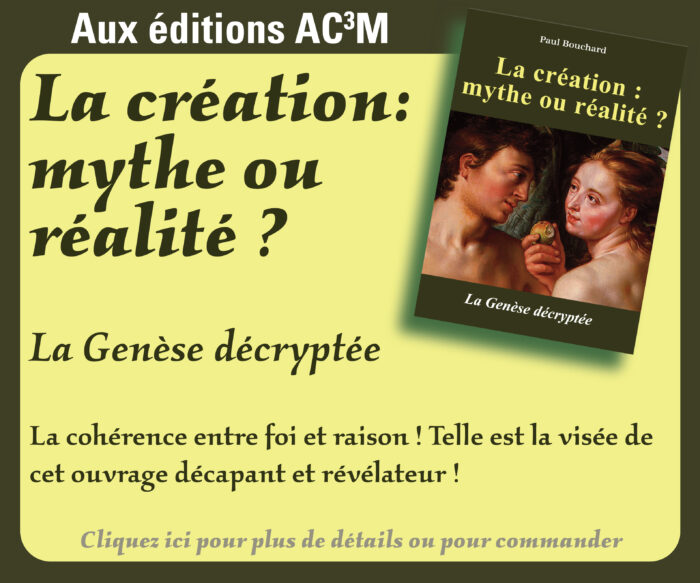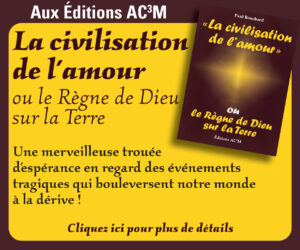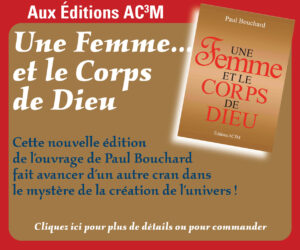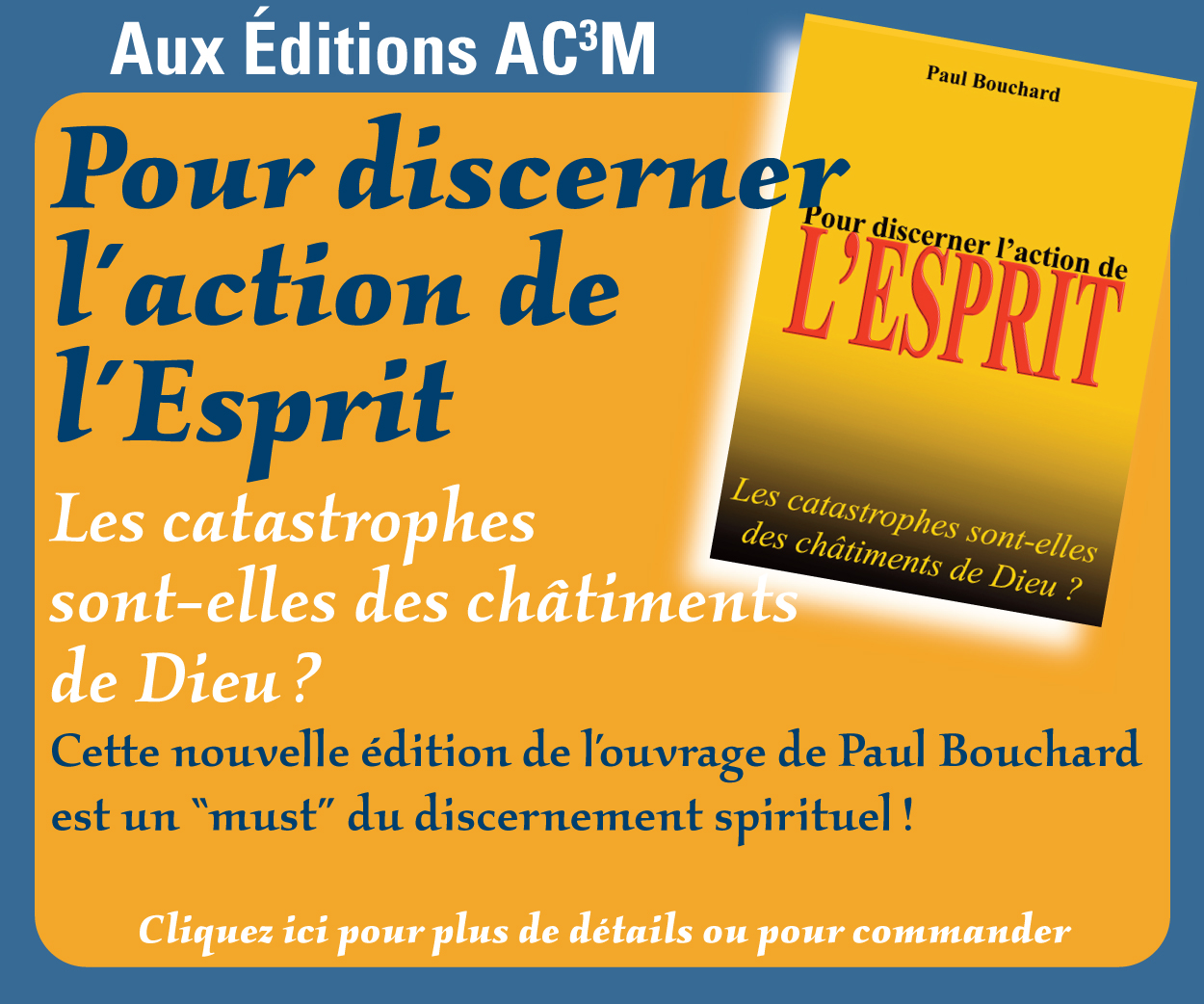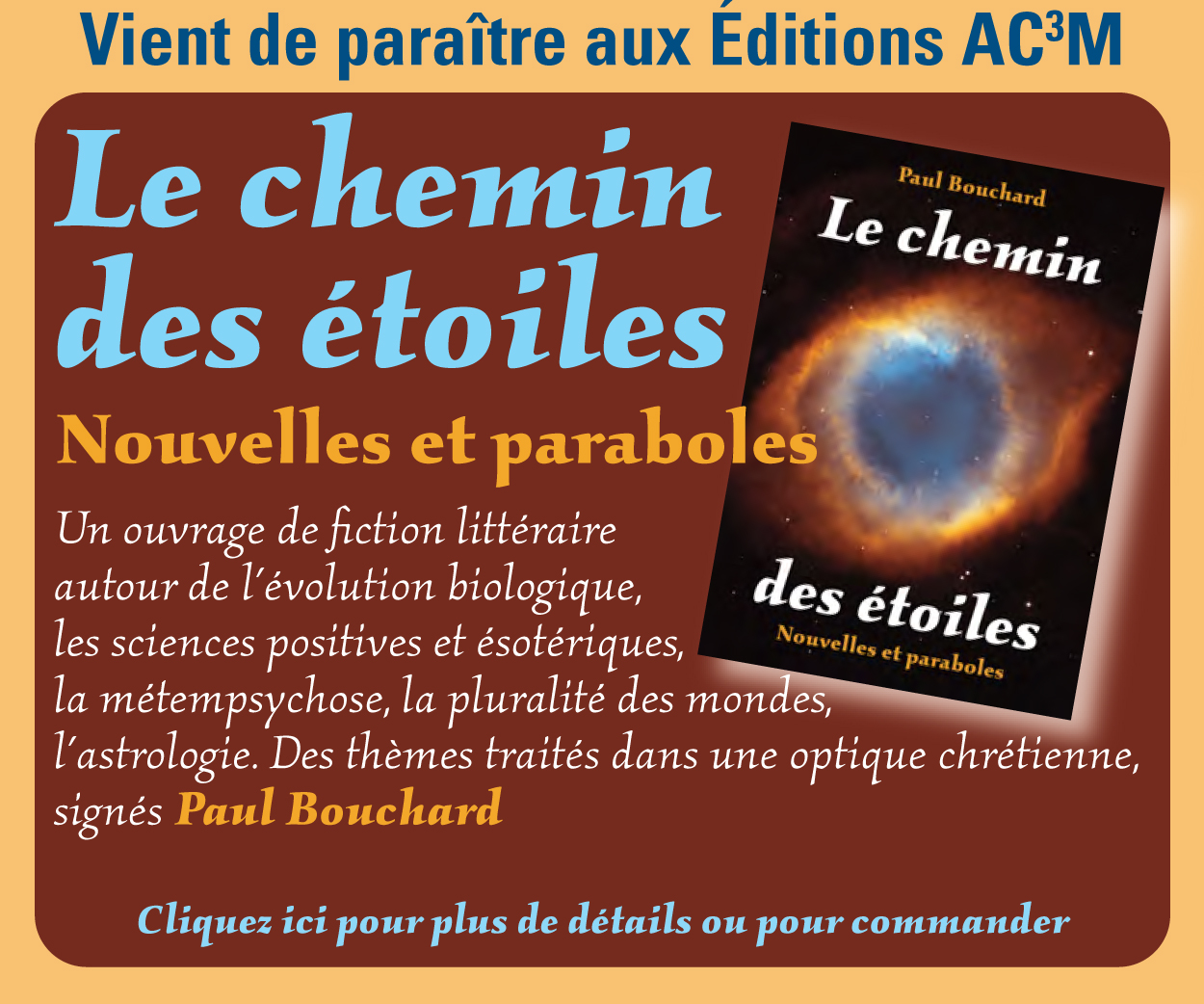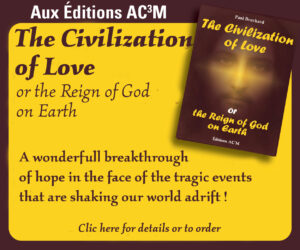Lorsque Dieu parle à l’humanité, avons-nous constaté, Son discours s’étale sur des siècles. Aussi, Sa parole dépasse les mots que les scribes ont utilisés pour exprimer leur pensée, décrire des événements historiques, chanter des psaumes et des cantiques, préciser les lois, déterminer les rituels liturgiques, etc. C’est en filigrane de leur démarche d’écriture que la Parole transcendante de Dieu se laisse véritablement entendre.

Les lieux de culte ne sont pas épargnés par les cataclysmes, comme cette église détruite par une tornade en Illinois
Souvent, les écrivains sacrés ne sont pas conscients de la portée de leurs écrits. L’auteur du Cantique des cantiques pouvait-il savoir que sa composition littéraire entrerait éventuellement dans la collection des livres sapientiaux de la Bible? Pouvait-il se douter que son poème, écrit pour célébrer l’amour conjugal, serait interprété, des siècles plus tard, comme décrivant les états mystiques de l’âme dans sa montée vers Dieu? (1)
Parole de Dieu versus parole de l’homme
Les scribes poursuivaient en écrivant un but qui leur était propre. Un but humain. La plupart d’entre eux étaient inconscients d’être inspirés par l’Esprit pour la rédaction de ce qui allait devenir, au fil des siècles, la Sainte Bible.
L’Écriture n’est donc pas uniquement Parole de Dieu s’adressant à l’homme. Elle porte aussi la marque d’une humanité qui chemine, qui évolue, qui cherche la vérité. Le «je t’aime» de Dieu à l’homme qu’est la Bible raconte aussi l’histoire de la découverte graduelle de Dieu par l’homme.
Au départ de ce cheminement, les Patriarches vénéraient El Shaddaï. Dieu a été adoré sous ce nom par un clan du désert avant d’être appelé Yahvé à partir de Moïse, lors de l’exode d’Égypte.
«Dieu parla à Moïse et lui dit: Je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddaï, mais mon nom de Yahvé, je ne leur ai pas fait connaître» (Ex 6, 2; cf. Ex 3, 13-15).
Le peuple hébreux a d’abord commencé par considérer Yahvé comme son Dieu particulier parmi les autres dieux qu’adoraient les nations. Yahvé s’est par la suite révélé un Dieu «jaloux» qui réclamait l’exclusivité.
«Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi. (…) Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux» (Ex 20, 3.5).
Par cette pseudo jalousie, Yahvé préparait Son peuple, à Le reconnaître éventuellement comme le seul véritable Dieu. «C’est à toi (le peuple hébreux) qu’il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que Yahvé est le vrai Dieu et qu’il n’y en a pas d’autre» (Dt 4, 35).
Les sacrifices d’animaux
Cette pédagogie progressive s’incarnait toutefois dans une nation qui avait déjà sa culture, son culte, sa manière de voir, de comprendre et de faire. Par exemple, c’était la coutume chez les Israélites —comme chez les autres peuples de la terre à cette époque-là— d’offrir à la divinité des holocaustes d’animaux, et parfois même des sacrifices humains.
L’humanité était encore dans l’enfance. L’on croyait naïvement se faire pardonner ses offenses et obtenir les faveurs divines en s’aspergeant du sang des animaux domestiques sacrifiés. Plus on sacrifiait, plus on croyait gagner la considération des dieux.
Aujourd’hui, exception faite de quelques populations attardées, plus aucune société moderne ne songerait à offrir des bœufs à Dieu. Et ceci, même chez les nations qui n’ont pas été touchées par le christianisme.
Les Israéliens qui militent actuellement pour la reconstruction du Temple de Jérusalem ne songent pas, que je sache, à revenir aux sacrifices d’animaux qui avaient cours au temps de Jésus. Du moins, s’ils prétendaient restaurer ce culte, ce serait au grand scandale de l’humanité tout entière. Une répulsion qui ne manifesterait pas pour autant de l’impiété. Tout au contraire!
Que s’est-il donc passé? D’où vient cette différence dans la perception de l’homme moderne? Dieu aurait-Il modifié Ses exigences et Ses goûts? N’est-ce pas plutôt l’homme qui a changé?
Cette répugnance généralisée face à des comportements religieux qui avaient cours jadis démontre un progrès dans la connaissance de Dieu. Le monde entier reconnaît maintenant que le culte et les rites précisés dans le Pentateuque(2) relèvent de coutumes barbares et primitives heureusement révolues dans l’humanité. Et ceci, même si les prescriptions que les Livres sacrés contiennent à propos des sacrifices ont été mises dans la bouche de Dieu s’adressant à Son peuple par l’intermédiaire de Moïse.
Les règles du culte mosaïque, qui devaient souvent être observées sous peine de mort, reflètent donc davantage les mentalités caduques et dépassées de nos ancêtres dans la foi qu’une volonté réelle de Dieu de se faire offrir la graisse et les entrailles des brebis et des bœufs dont «l’agréable odeur», lors de leur consommation par le feu, devait avoir pour effet d’«apaiser» Sa «colère» (cf. Lv 1, 1-17). Elles manifestent plus particulièrement le côté humain de la Parole divine, si je puis m’exprimer ainsi.
Donc, lorsque les auteurs du Pentateuque utilisent le style des oracles pour commander des holocaustes (Ex 29, 38-46) et préciser certaines ordonnances rituelles, il ne faut pas croire que Yahvé a prononcé mot pour mot les paroles mises dans Sa bouche. Nous devons plutôt comprendre que l’auteur ou les auteurs ont voulu ainsi conférer à des coutumes déjà établies (3) une signification transcendante en faisant remonter leur origine à un décret divin.
La lettre et l’esprit
Cette considération suffit pour écarter d’emblée les interprétations littérales à tendance fondamentaliste de la Bible. La Parole de Dieu ne réside pas dans le mot à mot mais se trouve dans la communion à l’Esprit qui l’a fait écrire au travers de l’épaisseur charnelle de l’humanité.
À s’en tenir fanatiquement à la lettre, on risquerait d’ailleurs d’être comptés parmi ceux, dénoncés par Jésus, qui «disent et ne font pas». Car exception faite des dix Commandements, on n’observe pas ou prou les prescriptions de la loi mosaïque. Ce qu’il faudrait faire obligatoirement pour être conséquent avec l’option de l’interprétation littérale.
De plus, interpréter au pied de la lettre chaque passage de l’Ancien Testament contraindrait à surmonter un nombre considérable de conflits et contradictions. Par exemple, comment concilier l’obligation, mise dans la bouche de Yahvé, d’offrir des sacrifices d’animaux avec le fait que les prophètes, qui parlent aussi au nom de Dieu, soutiennent qu’Il les a en horreur (4)? Comment surtout concilier ces sacrifices, obligatoires sous l’Ancienne Alliance, avec le fait qu’ils sont estimés sans valeur sous la Nouvelle (cf. He 9, 9 et 10, 1-4)?
Les lunettes humaines
Mais si nous apprenons à nous situer à une distance respectueuse du sens littéral de l’Écriture pour mieux saisir la véritable portée de la Parole de Dieu, nous comprendrons que la Bible témoigne du fait que l’humanité a d’abord commencé par balbutier comme un bébé avant d’apprendre à prononcer un peu mieux le nom de Dieu.
Nous comprendrons encore que les humains ont appris à connaître Dieu comme au travers de lunettes qui rendaient flous et plus ou moins déformés les contours de Son Visage. Sur un œil, la distorsion relevait de la nature, dégradée par l’activité des anges rebelles, et sur l’autre oeil, elle ressortait d’une humanité qui tâtonne dans les ténèbres depuis la première faute.
Pas surprenant qu’un tel lorgnon ait inspiré un nombre considérable d’anthropomorphismes (5) de l’Ancien Testament. Par ignorance, les hommes qui cherchaient sincèrement le visage de Dieu projetaient sur Lui leurs propres sentiments et conceptions. Ils ne pouvaient guère faire mieux que de Le ramener à leur niveau.
De sorte que le Dieu transcendant, le Dieu de Paix et de Joie, Celui qui a créé de rien l’univers, le Dieu qui est Amour et Bonté, l’Absolu infiniment aimable qu’aucun esprit humain ne peut comprendre s’est montré parfois colérique (Ex 4, 14), parfois jaloux (Ex 34, 14), parfois oublieux (Ex 2, 24), parfois retors (Ex 3, 21-22; 11, 2-3; 12, 35-36), parfois cruel (Ex 4, 24), parfois vengeur (Dt 32. 40-42) et même quelques fois trompeur (Gn 22, 1-6.11), pour ne pas dire menteur. Comme le disait je ne sais plus quel personnage célèbre: «Dieu nous a faits “à son image et à sa ressemblance” mais nous Le Lui avons bien rendu».
L’Amour infini
Tant que l’homme ne pouvait s’élever au-dessus de sa nature pour pénétrer à la suite du Christ dans la sphère surnaturelle, il ne pouvait véritablement connaître Dieu. Sinon au travers d’énigmes, de figures, de symboles… et de lunettes déformantes.
C’est pourquoi Jésus a pu déclarer: «Nul ne connaît le Père sinon le Fils et ceux à qui Il (le Fils) veut bien le révéler» (Lc 10, 22); «Personne ne va au Père si ce n’est par moi» (Jn 14, 6).
Avant le sacrifice du Fils sur la croix, les humains ne pouvaient faire autrement que de voir Dieu au travers de la culpabilité viscérale et originelle de leur nature. Ils en venaient ainsi à projeter sur Lui la colère que leur inspiraient leurs propres fautes.
Mais Dieu ne connaît pas la colère. Il n’a jamais éprouvé de haine à l’endroit de quiconque. Il ne condamne personne. Même pas Satan. Dieu aime Satan. Car Dieu demeure Amour toujours, sans faille et sans répit. Voilà bien le visage de Dieu que nous révèle Jésus Christ!
Ce sont nos péchés qui nous condamnent parce qu’ils constituent précisément une fermeture à l’amour de Dieu. Dieu, qui déteste le péché à cause de cet effet qu’il produit dans l’âme, continue à aimer le pécheur. Même celui qui ne se repent pas. Dieu ne refuse pas Son Amour même à ceux qui sont perdus. Il voudrait accueillir dans Son Amour tous les damnés de l’enfer et tous les anges déchus s’ils avaient la volonté de lever le mur qu’ils ont dressé librement entre Lui et eux.
Et l’enfer…?
J’entends ici une objection. N’est-ce pas un dogme de foi de croire que Dieu a créé aussi bien l’enfer que le Ciel? Pourquoi aurait-Il créé l’enfer s’Il continue à aimer les damnés?
C’est par miséricorde qu’Il a créé ce lieu de ténèbres où Il ne se manifeste pas visiblement. Il a créé l’enfer par compassion pour les esprits perdus de sorte qu’ils ne soient pas confrontés éternellement à Sa Présence. Dieu a créé l’enfer pour adoucir les douleurs du damné. Car la vue du Dieu-Amour serait en effet plus douloureuse pour le damné que l’enfer même.
La confrontation a eu lieu dans un court instant que nous appelons le jugement. À vrai dire, Dieu ne juge pas. C’est l’âme qui se juge et se précipite d’elle-même dans le seul lieu où elle peut aller pour fuir, non pas la vengeance de Dieu mais son Visage d’amour… qui lui apparaîtra cependant sous l’angle de la colère parce qu’elle Le voit au travers de la déformation qu’impose à sa vue son péché et sa haine de Dieu. Voilà pourquoi la plus grande souffrance des esprits damnés, c’est précisément d’avoir perçu dans un éclair cet amour de Dieu et de l’avoir refusé à jamais.
Notes
1- Saint Jean-de-la-Croix est l’un des auteurs qui ont interprété le Cantique des cantiques dans ce sens.
2- Le Pentateuque réfère aux cinq premiers livres de la Bible.
3- Ex 8, 21-23 démontre que les sacrifices d’animaux étaient une pratique établie dans le peuple hébreux avant l’exode. Donc, plusieurs siècles avant la rédaction de la loi mosaïque.
4- «Que m’importent vos innombrables sacrifices, dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir… N’apportez plus d’oblation vaine: c’est pour moi une fumée insupportable» (Is 1,11-13).
5- Selon le Petit Robert, ce terme désigne une «tendance à concevoir la divinité à l’image de l’homme».
Lire la suite, cinquième article
N. B. Cette série d’articles est tirée de Pour discerner l’action de l’Esprit, publié en 1998 aux Éditions Spirimédia.