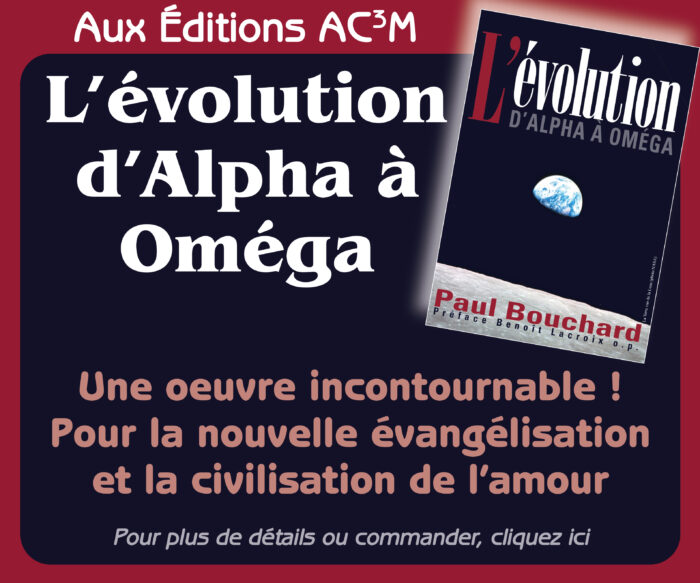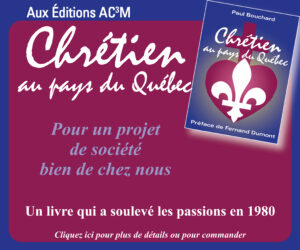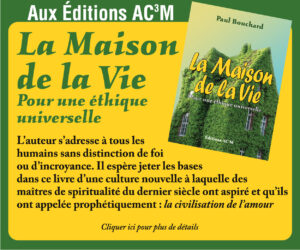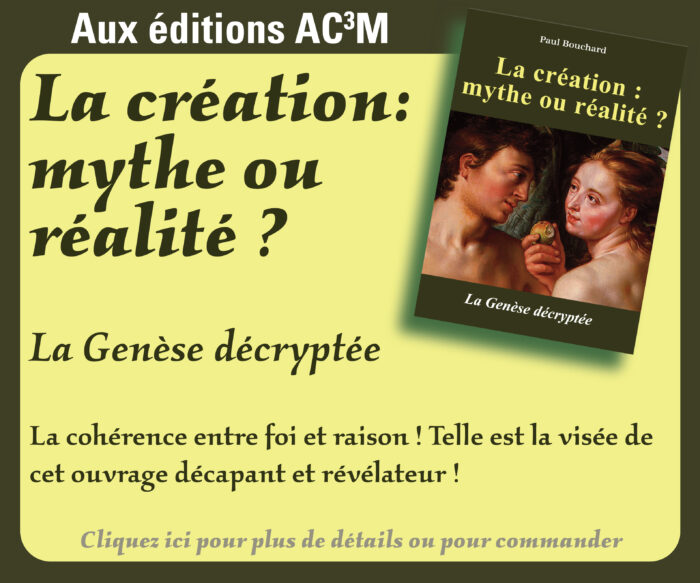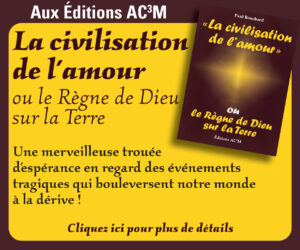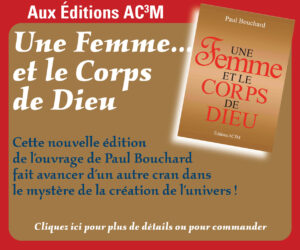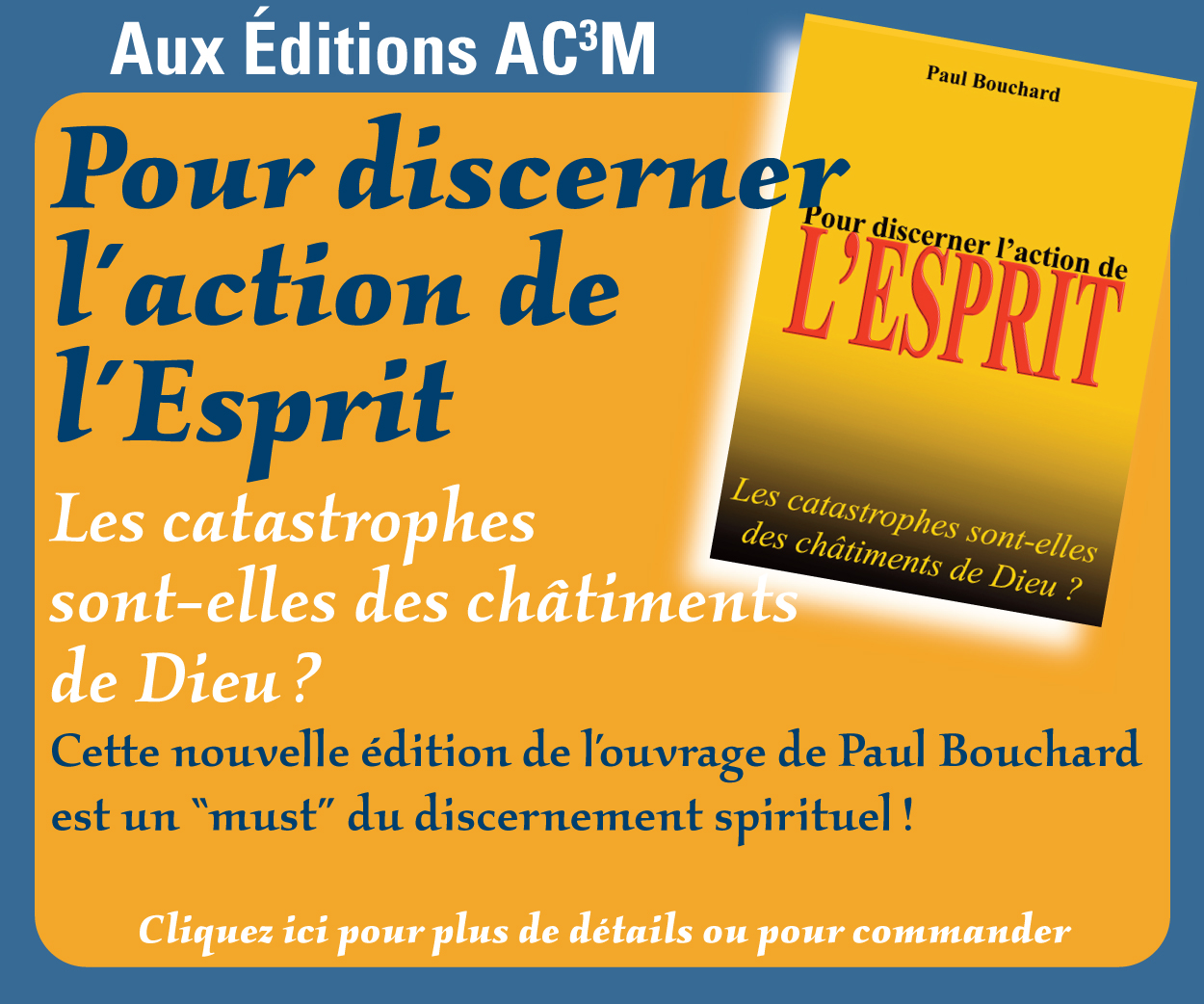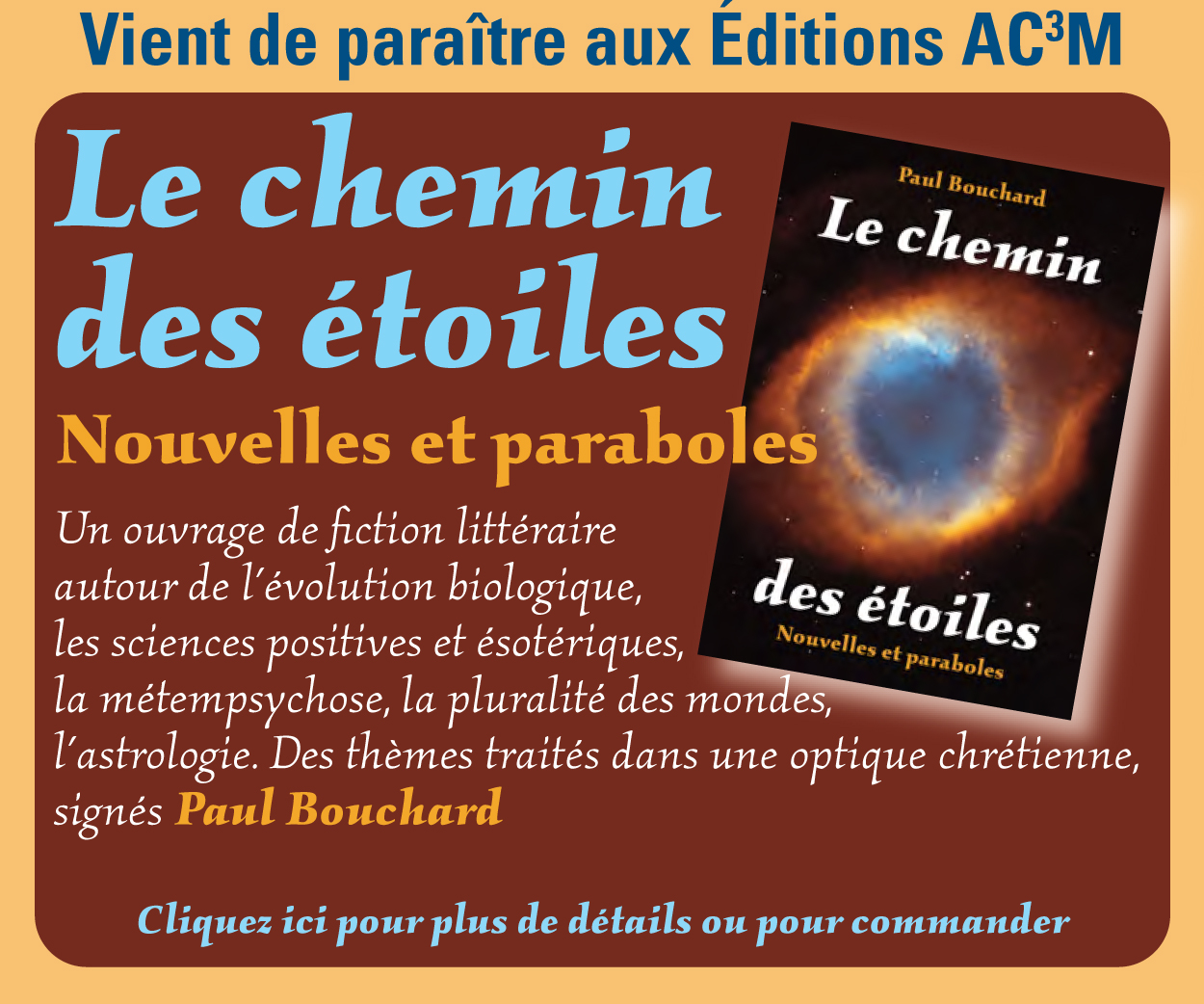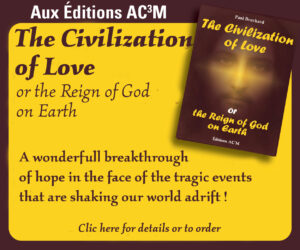La souffrance et la mort… des facteurs d’évolution?
À une époque où tant de scientifiques vivent une crise de la foi au nom de la science, Xavier Le Pichon, lui, a vécu une crise de la science au nom de la foi. En pleine lancée d’une carrière qui n’en finissait plus de rayonner, le chercheur lâche tout. Il craint de manquer le bateau de l’humanité et des vrais enjeux de l’existence. On le retrouvera alors chez une Mère Teresa à se plonger l’âme dans les yeux d’un enfant affamé jusqu’à en mourir. Puis, avec sa famille, il s’installera définitivement à l’Arche de Jean Vanier de Trosly-Breuil, où il humanisera son savoir au contact des handicapés mentaux. Et après trois années sabbatiques chez les pauvres d’intelligence et non de coeur, il renouera avec sa carrière scientifique pour servir, mieux encore, cette autre dimension de l’humanité qu’est la connaissance objective de l’univers.
P.B.: La doctrine chrétienne explique la souffrance et la mort dans le monde par la faute du premier couple humain. Or la souffrance et la mort sont des réalités présentes sur la terre depuis les premiers organismes, des milliards d’années avant la venue des humains. L’on peut donc les considérer comme des fatalités inévitables de la nature. Comment le premier péché aurait-il pu en être la cause puisque l’homme n’existait pas encore? Les chrétiens doivent-ils réinterpréter le dogme du péché originel?
P.B.: Et pourtant, selon l’enseignement de l’Église, le vieillissement et la mort n’existaient pas dans l’Éden!
X.L.P.: Évidemment, on peut imaginer un monde dans lequel on n’aurait jamais vieilli. Mais est-ce qu’on serait encore des hommes?
P.B.: Il faudrait qu’on soit spirituels, un peu comme les anges, n’est-ce pas?
X.L.P.: Ne pas vieillir impliquerait qu’on ne dépasse pas l’âge de dix-huit ans. À partir de cet âge, les cellules humaines commencent à subir un certain vieillissement.
D’autre part, si Adam et Ève avaient été créés immortels dans le paradis terrestre, ça voudrait dire que Dieu leur aurait retiré cette immortalité après la faute. Il aurait repris quelque chose qu’Il avait donnée.
Et ça, la tradition théologique la plus sûre nous dit que Dieu ne fait jamais ça. C’est l’homme dans son péché qui se détourne des dons qu’il a reçus. Par exemple, Dieu n’a pas retiré son intelligence et sa beauté à Lucifer. Donc, il y a peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas tout à fait dans notre conception de ce dogme.
Mais je crois qu’on peut trouver une voie de solution à ce problème en considérant le cas de la Sainte Vierge. Elle n’a pas été atteinte par le péché originel et, effectivement, elle n’a pas eu une fin comme nous. Jésus est venu la chercher dans son corps. Pie XII, en définissant le dogme de l’Assomption, s’est bien gardé de préciser si cette Assomption s’est produite avant ou après la mort de Marie. Ce que l’on sait, c’est que son corps n’a pas connu la décomposition. Il a été pris par Dieu.
Je ne suis pas théologien mais j’estime qu’il y a ici une possibilité de réconciliation entre la foi et la science. S’il n’y avait pas eu le péché originel, on n’aurait pas connu la mort parce qu’on aurait eu chacun notre assomption. Quand serait venu le moment de quitter la terre, Dieu nous aurait pris comme il a pris la Vierge. D’autre part, nous aurions pu ne pas connaître la souffrance mauvaise, le mal moral qui est l’effet du péché, tout en demeurant sensibles biologiquement.
À Pâques, on chante: «Ô mort, où est ta victoire!» Mais est-ce qu’on ne continue pas à mourir? Ce que Jésus a fait, c’est de nous donner la garantie d’une vie éternelle avec notre corps. D’autre part, il a vaincu la mort en ce sens qu’il nous donne la possibilité de faire de notre mort un acte d’amour, de faire que la souffrance soit un don. Au lieu que la souffrance écrase dans le désespoir et enferme dans la solitude, elle devient ainsi source de vie.
Pour ma part, je pense que si nos corps ne connaissaient pas la souffrance, le vieillissement et la mort, il manquerait quelque chose à notre expérience de vie. Chaque instant de notre vie est irremplaçable, chaque instant est unique et est fait pour être donné. En fait, on use son corps pour les autres.
Et quand on voit une Mère Teresa à la fin de sa vie, on voit bien qu’elle a usé son corps pour les autres et qu’en échange, elle a reçu une plénitude du coeur extraordinaire qui se voit sur son visage. Le visage qui reflète toute l’usure du corps pour les autres, je trouve ça magnifique! Et finalement, quand le corps est tellement usé, quand on a tout donné et qu’il reste plus rien à donner comme Jésus sur la croix, et bien, l’on part.
Je trouve ça très beau. C’est comme quelqu’un qui possède un magnifique piano et qu’il l’enferme dans un musée. À quoi sert-il? Dieu nous a donné un piano. À la fin de la vie, il est usé, il fait des sons quelques fois un peu cassés. Mais si l’on a très bien appris à jouer, les gens sont ravis. Ils sont contents. Ils ne font pas la remarque qu’on est vieux. Ils disent: on est bien près de lui, on est bien près de Mère Teresa, on est heureux. Et pourtant, elle a un vieux corps tout cassé avec les crises cardiaques à répétition. Mais mystérieusement, ça donne l’amour aux autres. Il y a une fatigue et une souffrance intérieures qui sont continuellement données pour l’autre et qui deviennent source de vie.
P.B.: Dans votre livre «Aux racines de l’homme», vous constatez que la souffrance en elle-même est un facteur d’évolution. Mais Dieu ne serait-Il pas responsable du mal s’Il a voulu une création dans laquelle la souffrance et la mort sont des nécessités structurelles d’évolution?
X.L.P.: La souffrance est un sujet extrêmement difficile. Devant une grande souffrance, il n’y a pas grand chose qu’on puisse dire. Jésus, d’ailleurs, parle très de peu de la souffrance. Il n’en parle pas mais il montre ce qu’il en fait. C’est-à-dire qu’il guérit, il console et puis, il va au sacrifice pour prendre cette souffrance et faire qu’elle ne soit pas désespérante.
Jean-Paul II, dans la lettre qu’il a écrite au lendemain de son attentat, «Le sens chrétien de la souffrance humaine», dit que la souffrance, d’une manière particulière, semble appartenir à la transcendance de l’homme. C’est une parole tout à fait étonnante. Elle m’a beaucoup marqué et touché.
La souffrance chez l’animal est un réflexe qui le protège des agressions contre le corps. Chez l’homme, il y a la souffrance de l’âme que nous appelons la souffrance au second degré. C’est-à-dire qu’on souffre de souffrir. On souffre de voir souffrir.
Et là, il y a tout un contexte qu’il est très difficile de démêler du péché. Qu’est-ce qui vient du péché, des nôtres d’abord, de ceux qui nous ont précédés et qu’est-ce qui vient du démon? On n’aime pas parler du démon mais il existait avant l’homme. Et il a fait tout ce qu’il a pu pour qu’il y ait des choses qui nous jouent des tours dans la création de Dieu.
Donc, il y a tout ce contexte qu’il ne faut pas essayer de démêler et chercher à tout expliquer. C’est vrai que la souffrance peut être vue comme une réalité épouvantable. Ce que dit Jésus, c’est: «Je suis venu pour couper le lien qu’il peut y avoir et qu’il y a souvent entre la souffrance et le péché, la souffrance et le mal. De sorte que vous puissiez vivre votre souffrance comme quelque chose qui, mystérieusement, va donner la vie». De la même manière qu’il s’est plongé dans l’eau du Jourdain pour être purifié —lui qui n’avait pas besoin d’être purifié, c’était pour purifier l’eau du Jourdain qui allait devenir l’eau de notre baptême—, de la même manière, il s’est plongé dans la souffrance, il a été jusqu’au bout de la souffrance pour que toute souffrance humaine devienne féconde. Mystère incroyable, qui peut être choquant pour certains mais, quand on y entre, on comprend que c’est un mystère de vie, de renaissance.
Le scandale, ce n’est pas tant la souffrance elle-même que le fait que nous laissions ceux qui souffrent s’enfermer dans la souffrance. Le scandale dans le monde, c’est le fait que ceux qui souffrent soient rejetés, soient marginalisés. Qu’on leur dise: «Votre souffrance, ça ne veut rien dire, ça sert à rien». On n’a pas le droit de dire à quelqu’un qui souffre que sa souffrance ne sert à rien.
P.B.: Avez-vous des raisons personnelles qui vous incitent à affirmer que la souffrance est un facteur d’évolution et de croissance?
X.L.P.: J’ai été très marqué par la souffrance que j’ai vue, aussi bien chez Mère Teresa que dans la communauté de l’Arche et dans ma vie personnelle. Ce qui m’a frappé, c’est de voir la transformation du milieu, de l’entourage d’une personne souffrante qui est accueillie et qui a la possibilité de commencer à vivre une espérance mystérieuse.
J’aime comparer ce mystère à l’Eucharistie. L’Eucharistie dans une église où personne ne vient, ce n’est pas magique, le village n’est pas transformé pour autant. Mais il suffit qu’il y ait quelques personnes qui se relaient pour prier et l’Eucharistie se met à rayonner.
De la même manière pour la personne souffrante. Si elle n’est pas accueillie, si elle n’est pas aimée, elle risque de s’enfermer dans le désespoir. Mais si elle est accueillie et aimée, il y a un grand changement.
Une expérience qui m’a beaucoup fait réfléchir a été la fin de vie de maman. Elle est morte de la maladie d’Alzeimer. C’est une maladie terrible qui détruit les neurones progressivement. On perd la personnalité, on perd la mémoire, on a des accès de démence et tout.
Pendant toute la durée de sa maladie, papa a décidé de vivre près d’elle à son service. C’est un homme d’action qui a quand même consacré les huit dernières années de la vie de maman à la servir, à changer ses couches, et le reste.
Quelque chose d’extraordinaire s’est passé: papa s’est mis à changer. Maman n’a jamais eu autant d’action sur lui que quand elle était la plus impuissante. À la fin il disait: «Mes enfants, je dois vous dire que je ne l’ai jamais autant aimée et que j’ai seulement maintenant compris ce que veut dire le sacrement du mariage.»
Après ces années de service, quand finalement elle est morte, il était inconsolable. Et il a vécu sept autres années avec son souvenir et le désir de la rejoindre auprès de Jésus. Qu’est-ce qui s’est passé? C’est justement ce mystère de la personne dans sa faiblesse, dans son impuissance et qui n’a plus rien à donner apparemment… Ma mère était une intellectuelle, une femme forte. Et là, elle n’était plus rien du tout. À la fin, elle ne reconnaissait même plus papa et c’est là qu’elle a eu le plus d’influence sur lui.
Mais ce n’était pas à sens unique. Papa lui a permis d’avoir une fin de vie digne et de garder l’espérance. À la toute fin, le Bon Dieu a donné à papa un petit signe. Trois mois avant sa mort —on croyait qu’elle ne savait plus écrire—, elle a écrit un mot: «Je voudrais bien savoir, mon Dieu, quand je serai enfin heureuse».
Ce mot a montré à papa qu’elle avait gardé toute son espérance. Ce n’est pas à sens unique. En accueillant la personne qui souffre, on aide son coeur à garder l’espérance. On l’aide à devenir une personne sainte, un sacrement d’amour, un sacrement de la présence de Jésus. Jésus a dit qu’il vit dans ces personnes. En même temps, les personnes qui souffrent donnent aux autres quelque chose de très mystérieux qui est la transformation de leur coeur.
C’est ce que Jésus nous dit partout dans son Évangile: «Si vous voulez aller au ciel, demandez à ceux qui souffrent et ils vous montreront la voie. Et pour ça, il faut que vous alliez vers eux, que vous les accueillez et c’est eux qui vont vous changer, qui vont vous faire évoluer»