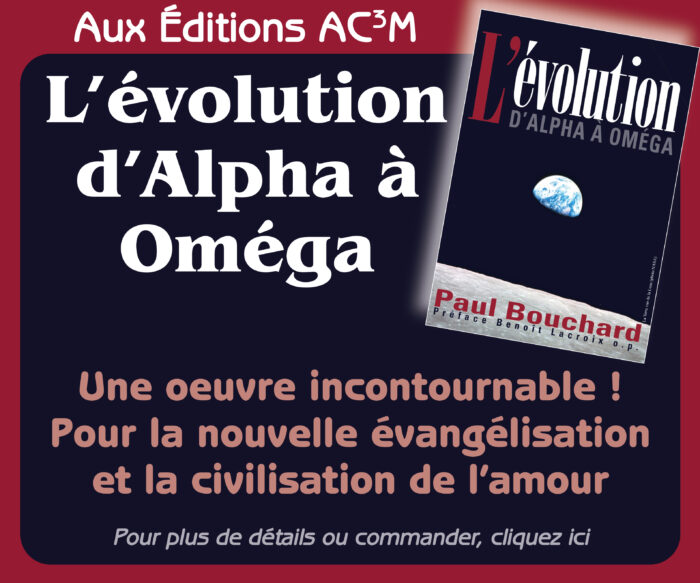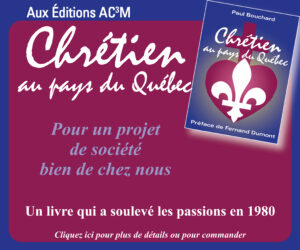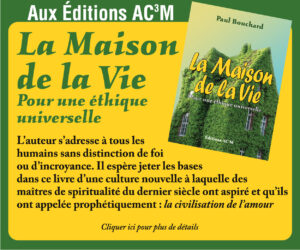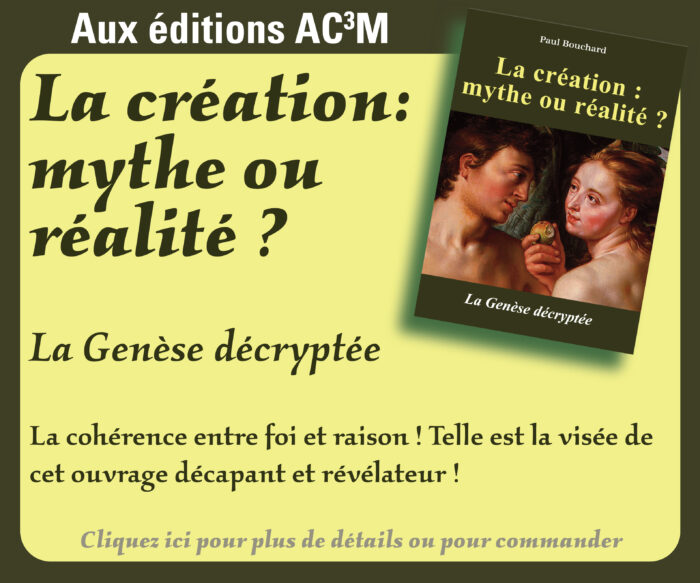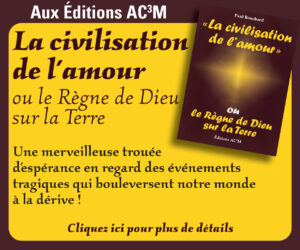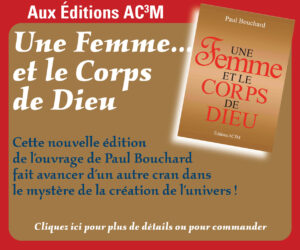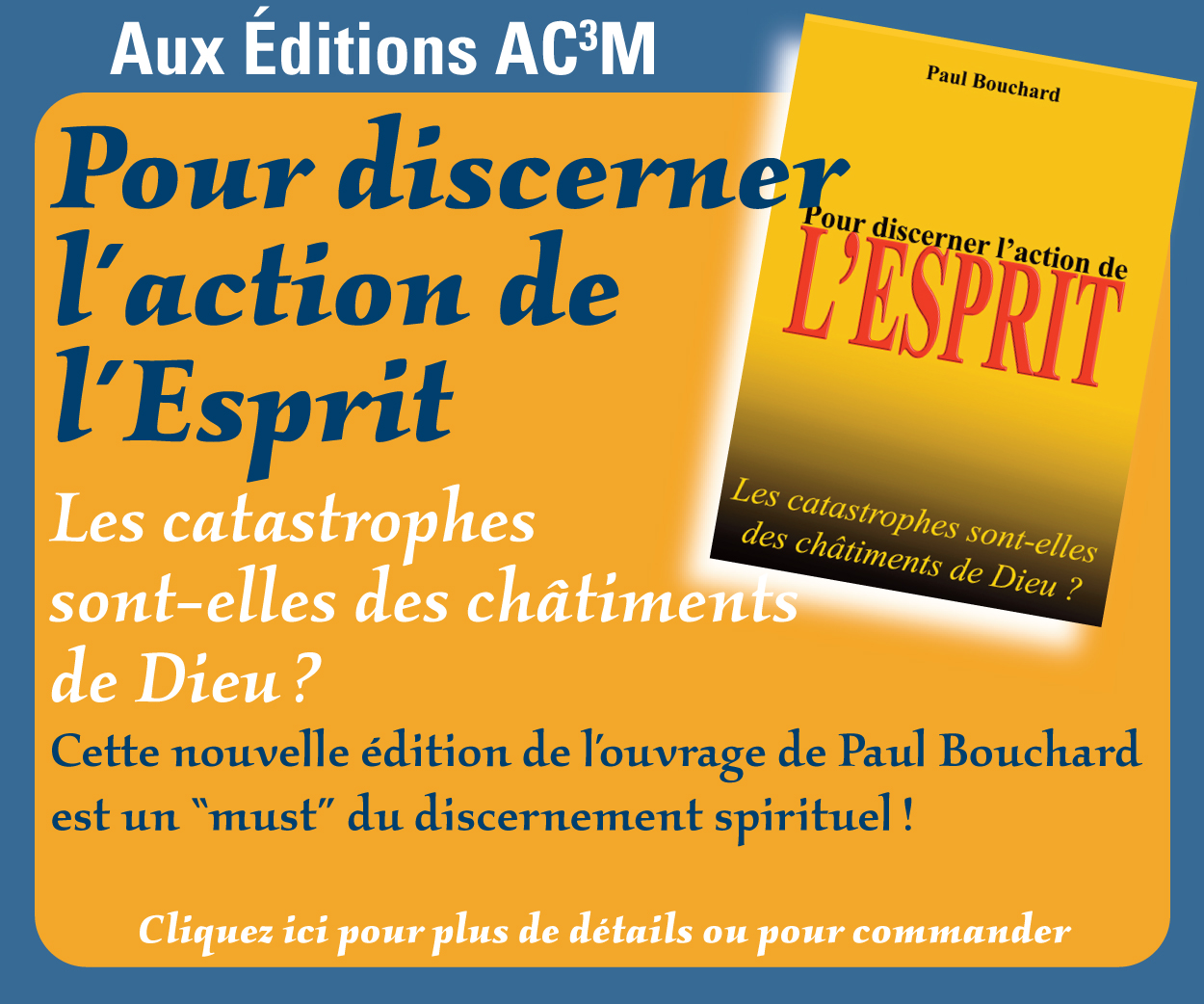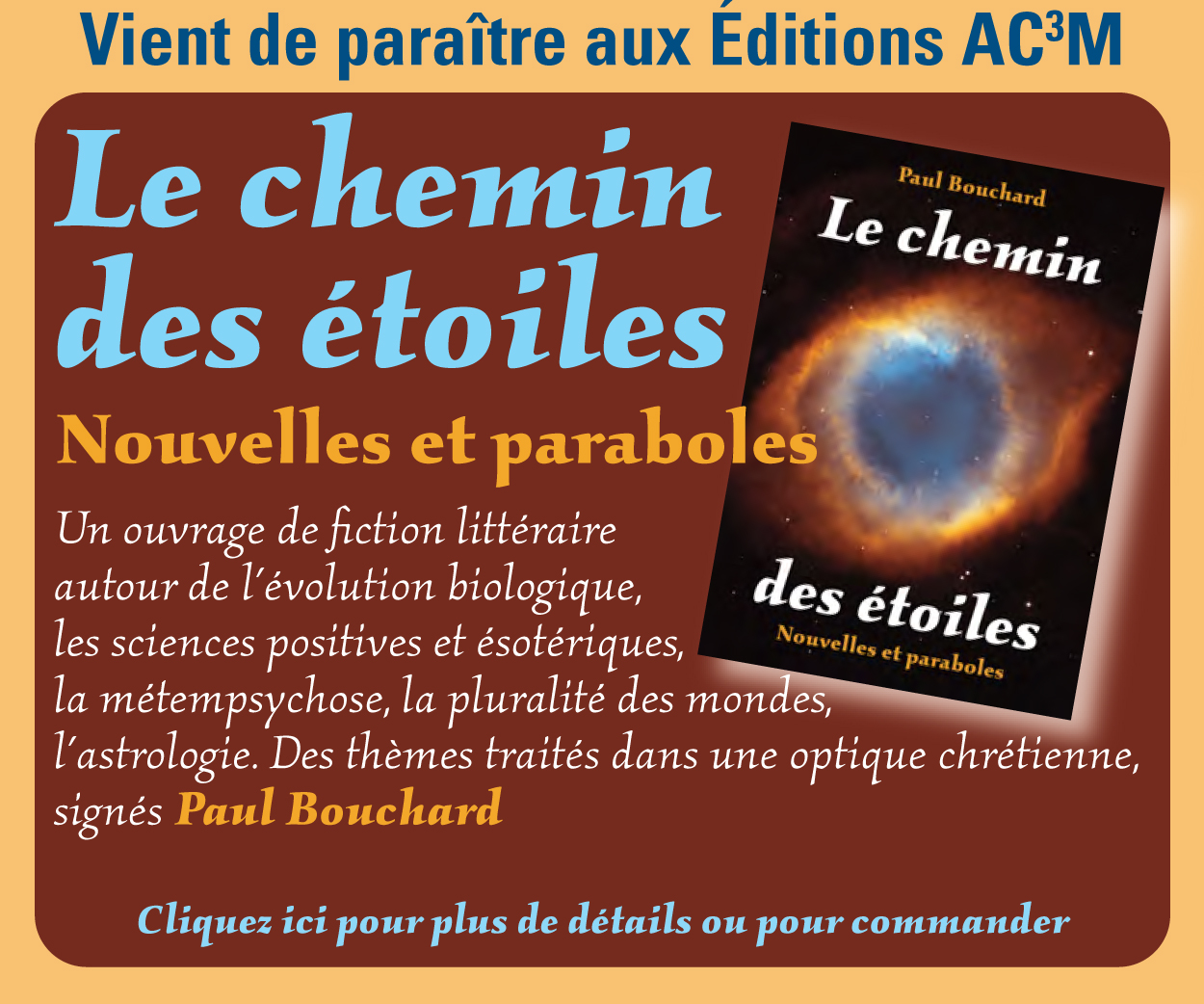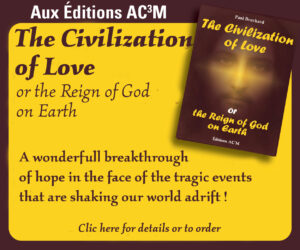Moïse ne tolère aucune contestation de son autorité. Sous son leadership, toute récrimination est immédiatement interprétée comme un péché de révolte contre Dieu et puni avec la plus extrême sévérité. Soit qu’un fléau mortel décime le peuple, soit que les coupables sont foudroyés sur le coup. L’histoire de Coré et de deux cent cinquante hauts dignitaires israélites est un exemple patent de cette intransigeance. Ils reprochaient à Moïse de «passer la mesure» en s’élevant «au-dessus de la communauté… C’est toute la communauté, ce sont tous ses membres qui sont consacrés» par la présence de «Yahvé au milieu d’eux» (Nb 16, 3), faisaient-ils valoir.

Les tremblements de terre ainsi que d’autres cataclysmes font prendre conscience de la précarité de la vie humaine et peuvent, de ce fait, provoquer des conversions (photo CNS/Mariana Bazo/Reuters).
Le Lévite était un démocrate avant la lettre. Sans doute ne pouvait-il plus avaler les diktats de Moïse (cf. 16, 12-15)! Et il aspirait à un gouvernement du peuple. Ne lui donnerions-nous pas raison aujourd’hui? Pas seulement pour la gouverne politique mais pour la doctrine religieuse. Sa conception de la communauté consacrée par la présence de Dieu n’est-elle pas prophétique? On la dirait issue de Vatican II!
Mais cet avant-gardisme lui coûtera la vie ainsi qu’à son groupe. Devant la Tente du Rendez-Vous où Moïse les convoque pour un rite d’offrande d’encens, la terre s’ouvre à la prière du prophète et engloutit vivants les contestataires avec leurs familles cependant que les porteurs d’encens sont consumés par un feu qui «jaillit de Yahvé» (Nb 16, 28-35).
Débordement charismatique
Nous assistons ici à un débordement du pouvoir charismatique de Moïse. Les Israélites en sont bien conscients car le lendemain, ils s’attroupent contre Moïse et Aaron pour se plaindre: «Vous avez fait périr le peuple de Yahvé» (Nb 17, 6). Ils ne disent pas «Yahvé a fait périr…» mais «vous…». Ils constatent que le prophète ne s’embarrasse plus d’exécuteurs de sentences pour faire respecter son autorité. Son «charisme» opère directement et n’épargne personne.
Pas même les proches. Tantôt, c’est la femme d’Aaron qui est frappée par la lèpre pour avoir «osé parler contre» lui (Nb 12, 8). Tantôt, deux des fils du prêtre sont brûlés vifs devant le Sanctuaire. Le motif de ce châtiment? Avoir présenté à Yahvé un rite d’encens non prévu par les règles du culte… telles qu’interprétées par Moïse, bien entendu (Lv 10, 1-7).
De telles «exécutions» sommaires par la puissance de l’Esprit inspirent une crainte sans bornes dans le peuple hébreu. Elles tissent le filet d’oppression d’une dictature sans pitié instituée au nom de Dieu. Le régime théocratique de Moïse ignore la miséricorde. Il révèle un Dieu terrifiant, un Dieu de colère et de vengeance, un Dieu qui fait marcher par la peur, fomente les fléaux et planifie les cataclysmes pour punir Son peuple, qu’Il menace à tout instant d’anéantir pour des peccadilles.
Ce Dieu-là est pratiquement aux antipodes du Père que Jésus manifestera plus tard. En réalité, le Dieu de Moïse est indissociable tant du caractère violent du prophète que des conditions de vie insupportables du peuple hébreu au désert. Il est plus la projection d’une certaine condition humaine que la révélation du Dieu véritable: l’Amour qui transcende l’univers.
«Pouvoirs» mal canalisés
Mais quelques millénaires plus tard, c’est vite dit de présumer que Moïse a pu abuser de ses pouvoirs surnaturels. Dieu déverse les dons de Son Esprit dans des vases bien fragiles. Moïse était un apprenti de l’Esprit.
Encore ici, l’évolution humaine a dû passer par un chemin ardu pour apprendre à canaliser les forces de l’Autre monde dans la bonne direction. Avant de parvenir à la sagesse de l’enseignement et de la pratique de Jésus, l’humanité, au travers des prophètes, a procédé comme à tâtons avec l’Esprit.
Moïse ne sera donc pas le dernier à s’intoxiquer de pouvoirs charismatiques au point de se croire au-dessus de l’humaine nature. Entre autres, le prophète Élie et l’apôtre Pierre tomberont ponctuellement dans le même piège.
Le feu d’Élie
L’Ecclésistique fait l’éloge d’Élie dont la «parole brûlait comme une torche» (Si 48, 1). L’expression est à prendre à la lettre puisque le prophète a fait descendre le feu du ciel à trois reprises, soutient Siracide (v. 3). «Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges, s’exclame-t-il! Qui peut dans son orgueil se faire ton égal?» (v. 4).
On connaît bien le récit de la compétition du Carmel (cf 1 R 18, 20-40). Élie est seul contre quatre cent cinquante prophètes de Baal. Il fait descendre le feu du ciel sur l’holocauste de Yahvé cependant que celui de Baal demeure intact, en dépit des incantations de ses prophètes. La victoire du prophète hébreu est célébrée par un massacre. «Élie les fit descendre près du torrent du Qishôn, et là il les égorgea» (18, 40).
L’on ne peut pas dire qu’Élie se soit servi directement de son charisme pour trancher les quatre cent cinquante gorges. En une autre occasion, pourtant, il n’hésitera pas à faire tomber le feu sur les deux premières troupes de cinquante hommes envoyés le quérir par le roi (2 R 1, 9-13). Dans le cas des prophètes de Jézabel, c’est tout de même l’exercice de son charisme qui lui occasionne son zèle sanguinaire, on ne peut plus excessif, pour Yahvé.
Mais le commandement de ne pas tuer s’applique à tous les humains sans exception, même les amis de Dieu. Aussi, lorsqu’Élie fuit au désert les représailles de Jézabel, son crime le hante. Il est tenaillé par un affreux sentiment de culpabilité (1). Il souhaite mourir. Au plus creux de la dépression, il prie Dieu: «C’en est assez maintenant, Yahvé! Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères» (1 R 19, 4).
L’histoire d’Ananie
Les Actes des Apôtres ne rapportent pas un repentir parallèle chez Pierre après l’exécution d’Ananie et de Saphire (cf. Ac 5, 1-12). Avant de faire don de leur propriété à la communauté, le couple s’était réservé une partie du prix de vente. Ce «mensonge» devait leur mériter une mort foudroyante, ordonnée par Pierre.
Le malheureux incident a pu se produire, me semble-t-il, en raison de l’inexpérience de Pierre avec les charismes de l’Esprit. La Pentecôte était encore récente. Pour les croyants regroupés autour des Apôtres, il restait encore bien des incertitudes dans la démarche communautaire à suivre.
Plus tard, les contours du domaine de l’Église se préciseront davantage. Si bien que j’imagine mal Pierre accomplir un «signe» (v. 12) aussi radical et extrémiste à la fin de sa vie.
L’épisode autorise cependant à supposer que Pierre a été tenté d’utiliser les charismes de l’Esprit pour une oeuvre communautaire différente de celle qui se manifestera plus clairement avec le temps. En tant que chef des Apôtres et de la communauté, il a jonglé pendant un certain temps avec la tentation de se croire un nouveau Moïse, capable de foudroyer par l’Esprit et habilité à exercer le jugement à tous les niveaux, même pour ce qui relève de la justice civile.
Le projet de Jésus
Mais ce n’était pas ce que voulait Jésus pour son Église. Plusieurs années ont pu s’écouler avant que les Apôtres parviennent à le comprendre tout à fait. Ils se sont souvenus alors que le jour même de sa mort, Jésus déclarait à Pilate que son Royaume n’était «pas de ce monde». Le Seigneur leur avait également enseigné de rendre «à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu».
En cela, le projet de Jésus se distinguait radicalement des conceptions socio-religieuses de ses contemporains. Sous la Première Alliance, on ne percevait pas une ligne claire de démarcation entre la vie politique et la religion. Les disciples de Jésus demeureront longtemps marqués par cette mentalité qui justifiait l’usage des moyens violents pour imposer la vérité religieuse.
«Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer?» (Lc 9, 54), demandent Jacques et Jean au retour d’une tournée d’évangélisation. Décidément, le charisme d’Élie brûlait encore dans l’esprit du temps.
Ce Jean est «l’apôtre que Jésus a aimé», l’auteur des épîtres et d’un évangile empreints d’une spiritualité stratosphérique. Mais pour l’heure, il manifeste une bien terrestre frustration. Les deux frères viennent en effet d’essuyer une rebuffade d’un village de Samarie. De là leur désir de représailles par le «feu du ciel». Leur aspiration à un pouvoir surnaturel de destruction se méritait cependant une vive réprimande (v. 55) de la part de Jésus.
Le fait que les deux disciples demandent la permission pour exercer ce charisme indique que Jésus détenait un tel pouvoir. Mais les nombreux signes qu’il a voulu accomplir pour appuyer sa mission étaient, sans équivoque, des actes qui construisent et non qui détruisent, des actes de bonté. Des actes qui reflétaient un autre visage de Dieu que celui de la colère et de la terreur. Le Visage de la miséricorde, du pardon, de la compassion.
Jésus «a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable» (Ac 10, 38). Dans le contexte du discours de Pierre rapporté ici, ce «pouvoir du diable» doit s’entendre dans un sens large et non dans le sens restrictif des possessions diaboliques. Il s’agit d’un pouvoir de Satan sur la création tout entière qui s’étend à toutes les formes et effets du mal de quelque nature qu’il soit.
Les exécutions «surnaturelles» accomplies par Moïse, Élie et Pierre étaient un effet du mal, une manifestation du pouvoir de Satan, même si ce mal était perpétré, soi-disant, au nom de Dieu. Bien que Jésus ait été doué de pouvoirs charismatiques plus que tous les prophètes réunis, il n’aurait jamais agi ainsi.
Jésus a combattu le mal non par le mal mais par le bien, par l’amour. Et plutôt que de répondre au mal par la violence, il a enjoint ses disciples à aimer les ennemis et à prier pour les persécuteurs, imitant ainsi, a-t-il précisé, la miséricorde du Père qui «fait lever son soleil sur les méchants et les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes» (Mt 5, 45).
Le soleil pourvoit chaleur et lumière; la pluie rend fertile la terre. Dieu dispense généreusement et sans discrimination. N’émane de Lui que le positif, le bien, la bonté. Sa volonté est de rendre féconde toute vie. Aussi bien au plan terrestre —où bons et méchants doivent partager la même condition humaine et se soumettre indistinctement aux mêmes contingences— qu’au plan surnaturel. Il fait briller le Soleil de son Esprit sur tous les hommes et fait pleuvoir Sa Grâce sur les pécheurs comme sur les saints.
Car qui sait si demain l’ennemi juré ne se muera pas en ami très cher? Et qui peut dire si, aujourd’hui-même, le criminel d’hier n’entrera pas dans le Cœur de Dieu (cf. Lc 23, 43)?
Note
1- L’on peut apercevoir, en filigrane des récits de l’exécution du groupe de Coré ainsi que des deux fils d’Aaron, des traces d’un semblable sentiment de culpabilité qu’aurait éprouvé Moïse. Dans le premier cas, le prophète ordonne que les encensoirs des partisans de Coré, «sanctifiés au prix de la vie de ces hommes» (Nb 17,3), soient battus en plaques pour recouvrir l’autel. Il tentera également de consoler Aaron de la perte de ses fils en lui recommandant de ne pas se mettre en deuil car «c’est toute la maison d’Israël qui pleurera vos frères, ces victimes du feu de Yahvé» (Lv 10,6). (Lire la suite, huitième article)
N. B. Cette série d’articles est tirée de Pour discerner l’action de l’Esprit, publié en 1998 aux Éditions Spirimédia.