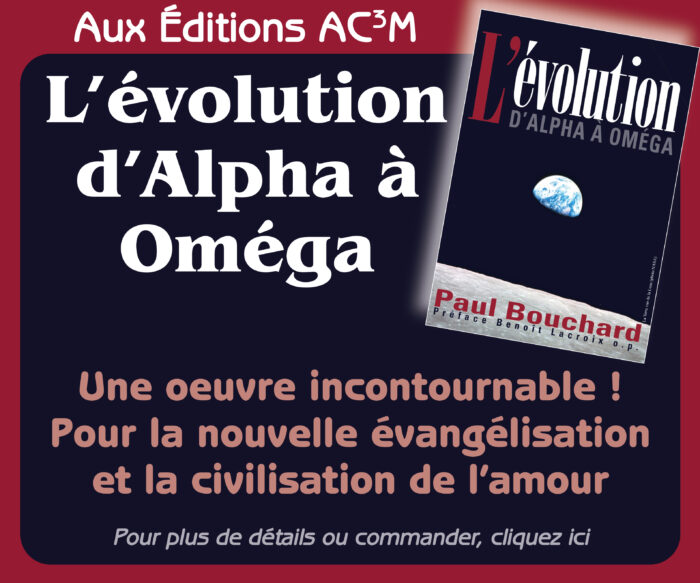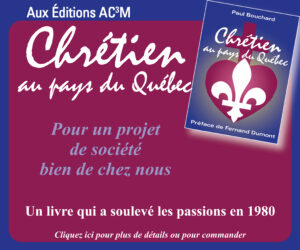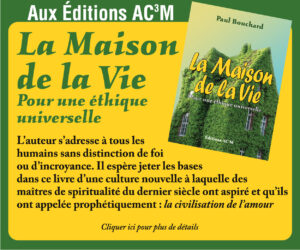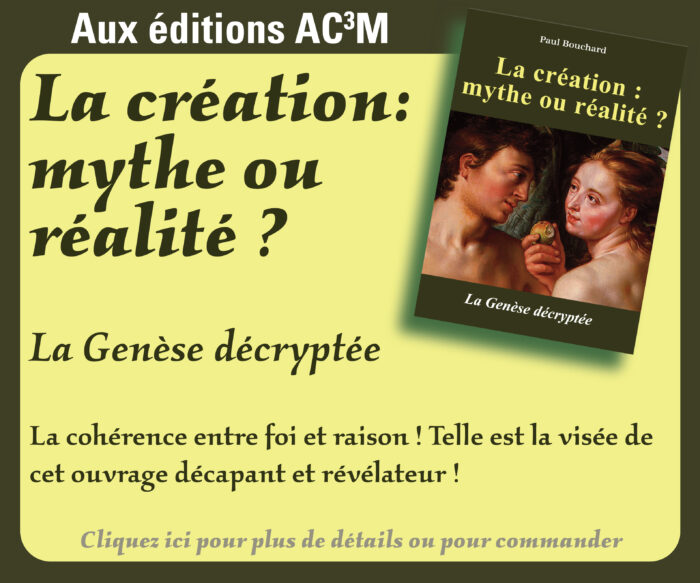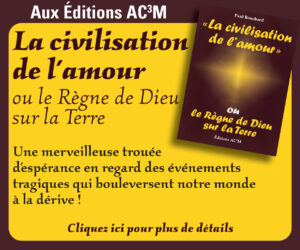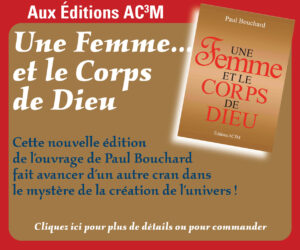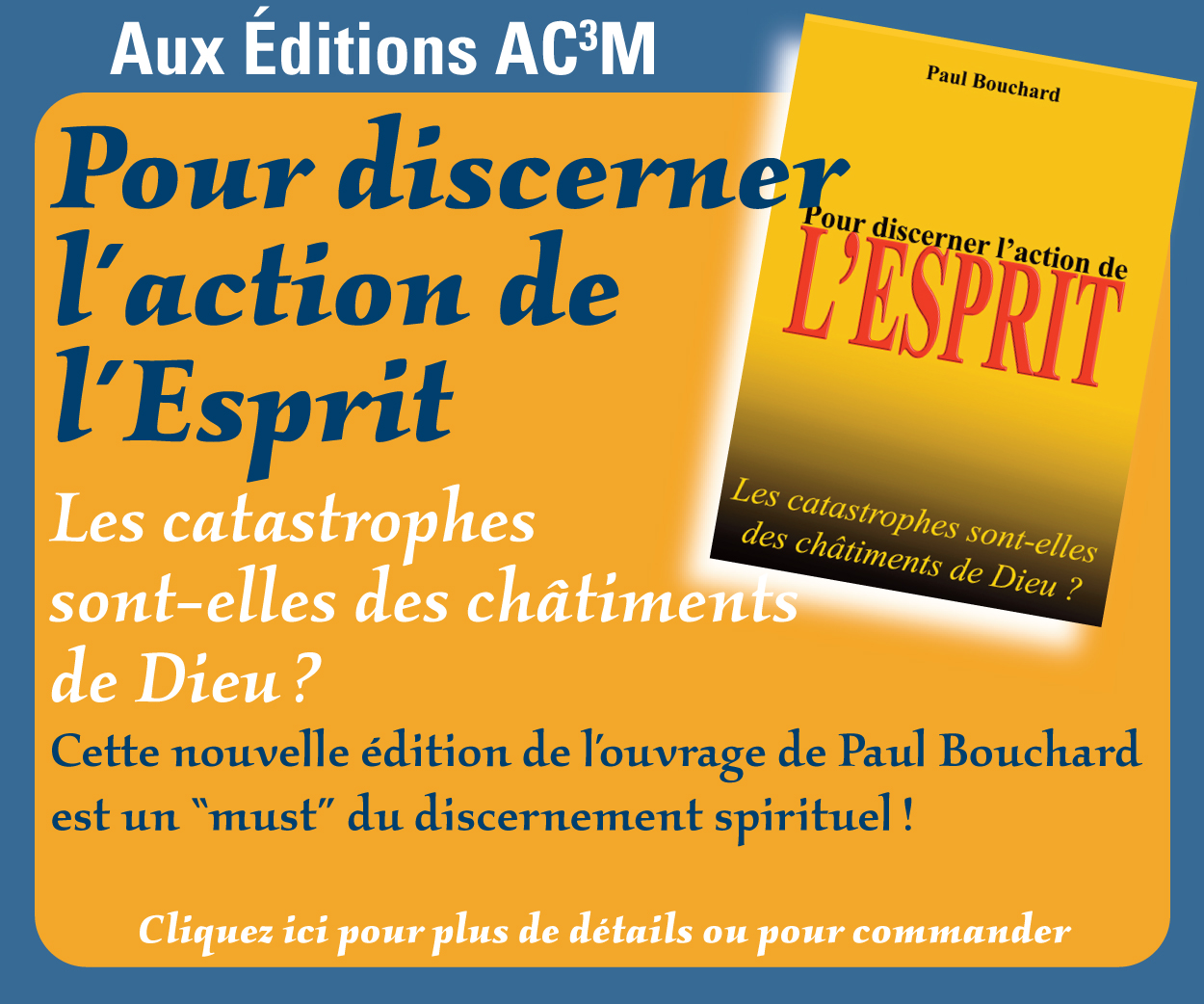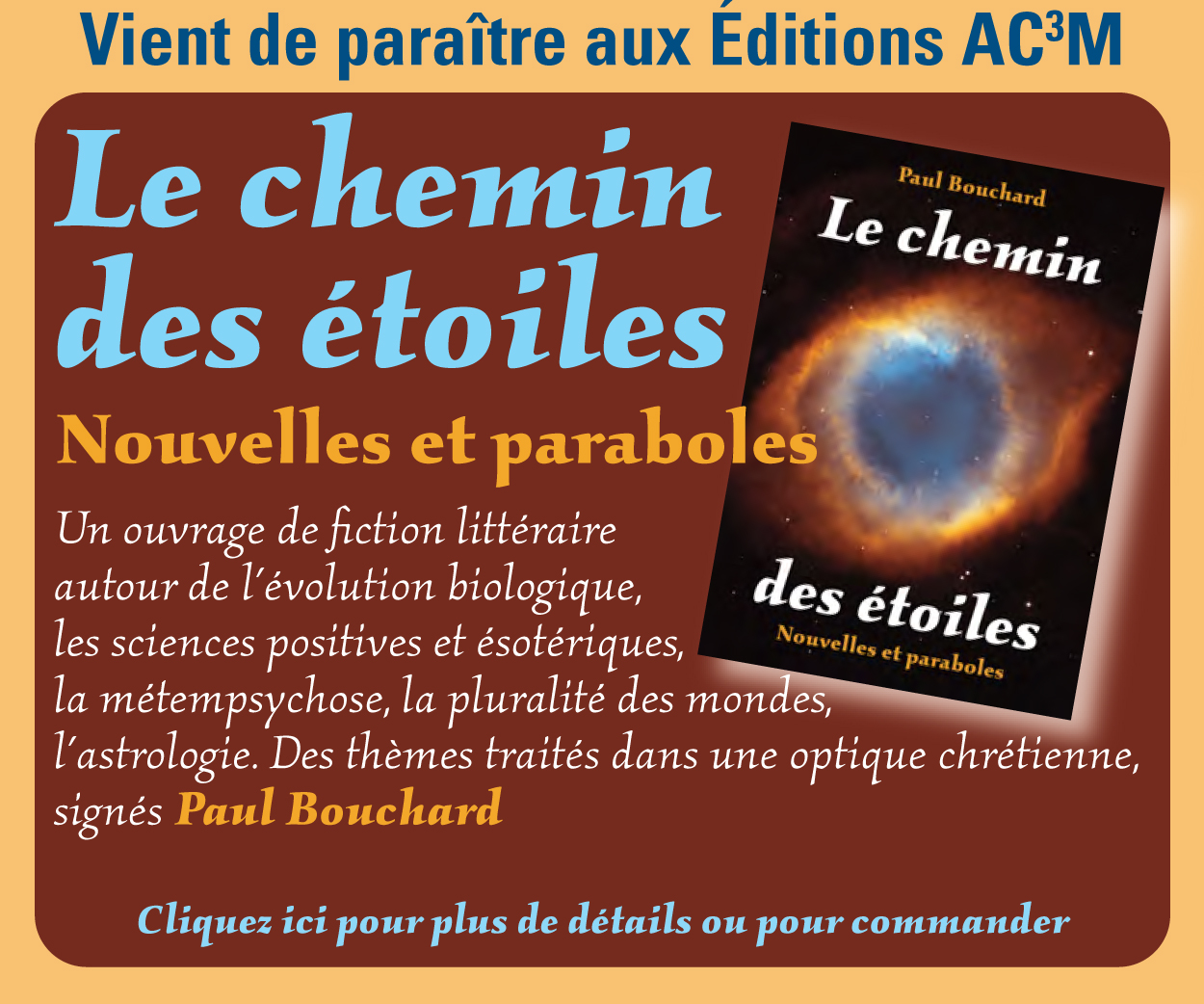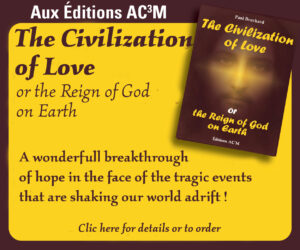Selon une thèse accréditée, l’aventure historique de l’humanité en matière religieuse serait partie de l’animisme. Cette religion est la plus primitive que nous connaissions. Pour l’animiste, le monde visible n’est qu’une apparence derrière laquelle se cachent des esprits. Chaque objet matériel est habité par une âme qui cause son comportement, tout comme analogiquement l’âme anime le corps. Parce qu’elle ignore l’explication objective des phénomènes, la religion animiste développe une vision superstitieuse de la réalité et plonge l’esprit humain dans un monde de peurs et de servilité. D’autre part, en amalgamant le monde des esprits à la matière, cette religion pave la voie au panthéisme et au polythéisme auxquels adhère encore actuellement une proportion importante de la population mondiale.
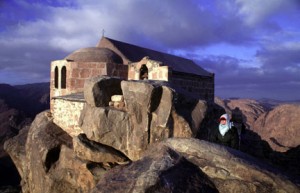
Au sommet du Mont Sinaï, on trouve aujourd’hui une chapelle reliée au monastère Ste-Catherine du sixième siècle ( photo CNS/Norbert Schiller).
La religion animiste, quant à elle, régresse au rythme de l’assimilation des peuplades primitives à la culture contemporaine. Elle ne résiste pas à une confrontation à l’esprit scientifique et au développement des connaissances objectives. Elle ne fait pas bon ménage non plus avec les conceptions religieuses monothéistes à la pointe de la civilisation moderne qui distinguent radicalement l’esprit de la matière.
À la frontière de la conception animiste
L’expérience religieuse qu’ont vécue les Hébreux au désert se situe à la frontière de la conception animiste de la réalité tout en s’en démarquant suffisamment pour inspirer le développement éventuel du monothéisme, c’est-à-dire la foi en un seul Dieu. Il s’agit d’un événement charnière dans l’histoire de ce peuple qui articule le passage d’une perception matérialiste de la divinité à une conception plus spirituelle.
D’après une note de la Bible de Jérusalem (Ex 19,16), le récit de la théophanie (manifestation visible de Dieu au Sinaï) a été composé principalement à partir de deux sources qui attribuent à l’événement deux contextes bien différents. La première source situe l’Apparition de Yahvé dans le cadre d’un violent orage de montagne comme il peut s’en produire dans la partie nord d’Israël de tradition élohiste. «Dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne… Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre» (Ex 19, 16 et 19).
La deuxième source décrit l’événement comme une éruption volcanique. La tradition yahviste, établie dans la partie sud du pays à proximité des volcans au nord de l’Arabie, est à l’origine de ce compte-rendu. «La montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu; la fumée s’en élevait comme d’une fournaise et toute la montagne tremblait violemment» (Ex 19, 18; cf. 24, 15-18; Dt 4, 11-12; 5, 23-24; 9, 15).
Remarquons que si l’éruption est attribuée à la descente de Dieu du firmament pour Se poser «au sommet de la montagne» (Ex 19, 20), elle n’est pas confondue avec Lui. Yahvé descend dans le feu mais Il n’est pas le feu. Il parle dans le tonnerre mais Il n’est pas le tonnerre. Sa Présence est distincte des phénomènes naturels que son apparition déclenche. C’est cette distinction qui démarque dans un premier temps les Israélites du relent animiste.
Un autre point qui démontre une distanciation par rapport à la mentalité religieuse primitive, c’est le fait que Moïse «délimite le pourtour de la montagne» (Ex 19, 12) pour séparer l’apparition divine et le peuple, qui doit rester en bas et pas même toucher à la montagne sous peine de mort. Voilà un début de frontière tracée entre le sacré et le profane. L’animiste ne fait pas une telle distinction puisque, pour lui, tout est sacré et habité par des présences surnaturelles.
Enfin, la montagne ne détient pas son statut sacré par elle-même mais à cause de la Présence divine. Yahvé n’est pas la montagne, Il n’est pas fait de matière, Il n’est pas une idole inanimée mais un Être vivant qui parle et exige des comportements bien précis du peuple qu’Il adopte.
Cette relation privilégiée préviendra le peuple hébreux de s’engager sur la voie du polythéisme ou du panthéisme. L’expérience du Sinaï amorcera plutôt pour lui —et pour l’humanité, éventuellement— l’«apprentissage» d’un nouveau concept religieux, l’aiguillage dans un filon d’évolution qui aura le vent du devenir dans les voiles: le monothéisme.
Les deux versions
Le sens historique sans précédent de la théophanie du Sinaï étant dégagé, revenons à la question des deux sites décrits dans l’Exode comme cadre de l’événement. Où faut-il le situer: dans les montagnes du nord d’Israël pour être consistant avec la description de l’ouragan de la tradition élohiste ou en Arabie pour l’éruption en accord avec la tradition yahviste?
Cette interrogation, qui risque d’être jugée impertinente par celui qui s’en tient à une lecture littérale de la Bible, fournit l’occasion de mieux comprendre les conditions de rédaction des Écritures. Les récits bibliques en général, et celui-là en particulier, ont été transmis oralement d’une génération à l’autre, souvent pendant plusieurs décennies, voire même des siècles, avant d’être mis par écrit.
Or, dans la tradition orale, chacun raconte les faits historiques à sa manière, les décrit avec les mots qu’il a et dans le contexte de vie qu’il connaît. Et pour évoquer l’apparition du Créateur de l’univers, ne se doit-on pas d’utiliser les expressions les plus saisissantes que l’on puisse trouver et le contexte le plus impressionnant que l’on soit capable d’imaginer?
C’est pourquoi les conteurs du nord ont décrit un violent orage et ceux du sud, une éruption. Dans un premier temps, chacune des traditions a fini par mettre par écrit sa version de l’histoire. Et ce sont ces «fragments», dans un deuxième temps, dont le ou les rédacteurs de l’Exode se sont servis pour aboutir au récit que nous avons aujourd’hui sous les yeux.
La «brise légère»
Si donc nous tenons compte de ces contingences de rédaction, nous devrons convenir que la tempête ou l’éruption sont des outils littéraires utilisés par les rédacteurs pour illustrer la transcendance de Dieu dont la manifestation au niveau de la nature produirait des cataclysmes. Ces images sont ce que les auteurs ont pu trouver de mieux pour exprimer la Super-Réalité divine, qui dépasse toute compréhension. Réalité d’un autre ordre —l’ordre surnaturel— qui, de notre point de vue contemporain, n’a en fait strictement rien à voir ni avec une tempête ni une éruption volcanique.
Ce qui laisse pendante la question de savoir ce qui s’est vraiment passé au Sinaï. À titre exploratoire, je propose deux hypothèses. La première est que Dieu a pu souffler à l’oreille de Moïse «le bruit d’une brise légère» (1 Ro 19, 12) pour lui inspirer la Loi et les Commandements. En d’autres mots, Il a pu simplement parler au cœur de Moïse sans mise en scène spectaculaire. Le prophète avait un tel empire sur le peuple qu’il était parvenu à libérer de la servitude d’Égypte que ce dernier a cru en lui et lui a obéi comme porte-parole de la volonté divine.
La «brise légère», c’est l’effet de la Présence de Dieu qu’Élie a découvert quelques siècles plus tard sur le même lieu, après que le monothéisme soit parvenu à faire plus amplement son chemin dans la mentalité et la culture du peuple hébreu. Le prophète a marché quarante jours pour parvenir à l’Horeb, la montagne où Dieu était apparu à Moïse, dans l’espoir de rééditer et réactualiser la théophanie. Contre toutes ses attentes, il a dû se rendre à l’évidence que Dieu n’était pas dans l’ouragan à fendre les montagnes, qu’Il n’était pas non plus dans le tremblement de terre ni dans le feu. Mais dès qu’il entendit la brise, «il se voila le visage avec son manteau» (1 Ro 19, 11-13) pour ne pas mourir en regardant Yahvé passer.
Non certes que Dieu aurait voulu causer sa mort. Les Anciens affirmaient qu’on ne pouvait voir Dieu sans mourir (cf. Dt 5, 26; Ex 33, 20). Ils devinaient que notre fragile structure charnelle ne pourrait résister à la contemplation d’un Dieu qui transcende le créé.
Mise en scène
Ma deuxième hypothèse se veut une concession aux projections anthropomorphiques qui caractérisent le Pentateuque. Elle suggère que Dieu aurait voulu Se manifester au milieu d’une nature déchaînée pour adapter Son enseignement à un peuple rébarbatif qui avait besoin de coups d’éclat pour être touché. Par une mise en scène dramatique, Il aurait ainsi inspiré une crainte opportune au «peuple à la nuque raide» (Ex 32, 9) qu’Il s’était choisi dans le but de le redresser de ses mauvais penchants et de le faire avancer sur le chemin de la vie.
Ainsi, en se manifestant réellement dans le cadre d’un phénomène naturel violent, Dieu (ou ce pourrait-il que ce soit Moïse qui aurait pu profiter de circonstances météorologiques impressionnantes pour consolider son autorité?) aurait agi un peu comme un papa qui, en bon pédagogue, sait se faire craindre et simule la colère au besoin pour s’assurer de l’obéissance de son fils chéri.
C’est d’ailleurs ce que laisse entendre Moïse lorsqu’il déclare au peuple saisi de frayeur devant les phénomènes cataclysmiques: «Ne craignez pas. C’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne pêchiez pas» (Ex 20, 20).
La peine de mort
Cette hypothèse ne résout pas un problème, pourtant. Quel bon papa irait jusqu’à menacer son enfant de mort s’il osait toucher aux cailloux de son jardin? C’est bien ce que Dieu aurait décrété à l’intention du peuple hébreu par l’intermédiaire de Moïse. «Gardez-vous de gravir la montagne et même d’en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui; il sera lapidé ou percé de flèches, homme ou bête, il ne vivra pas» (Ex 19, 12-13).
Difficile à prendre aujourd’hui un châtiment aussi radical pour moins qu’une peccadille… et même pour rien du tout (1). Est-il possible que Dieu ait vraiment interdit de toucher à un rocher, fut-il sacré, sous peine de mort? «Toutes les montagnes sont à Lui», chante un psaume. Aurait-Il de la prédilection pour telle montagne particulière? N’est-ce pas avant tout pour les humains, de quelque temps et culture qu’ils soient, qu’Il réserve sa prédilection?
Là encore, il ne faudrait pas prendre la Bible au pied de la lettre mais laisser plutôt une généreuse part aux balbutiements humains dans la connaissance de Dieu. L’interdiction de toucher à une pierre du Sinaï sous peine de mort est à mettre sur le compte des tabous et interdits irrationnels qui relèvent de l’ignorance animiste.
Pour la quasi totalité des hommes et des femmes d’aujourd’hui, de telles contraintes sont inhumaines et insensées. Or, Celui qui a fait l’homme à son image, serait-Il moins humain que l’homme? Si donc l’interdiction de toucher à la montagne était plus adaptée à la mentalité des contemporains de Moïse, ce n’est pas parce que Dieu, qui est immuable, a changé. C’est l’homme qui a changé et, conséquemment, sa conception de Dieu et ses rapports avec Lui.
1 La peine capitale est quasi le seul châtiment que connaisse le Pentateuque, pour les fautes les plus graves aux plus légères… et même pour des actes qui ne seraient pas du tout considérés comme des fautes aujourd’hui. Comme le fait d’approcher du lieu sacré de la Demeure du Témoignage (Lv 1, 50) ou d’avoir des relations conjugales pendant les menstruations (Lv 20, 18) ou de ramasser du bois le jour du sabbat (Nb 16, 32-36). Il est cependant à noter que c’est invariablement par la main de l’homme que la lapidation était exécutée… au nom de Dieu. Il y a encore de nos jours des zélés qui exécutent des innocents au nom de Dieu. Ces «châtiments» comptent parmi les atrocités et les horreurs les plus abominables que l’homme cruel et méchant ait pu inventer. Qui voudrait encore soutenir qu’ils sont ordonnés par Dieu? Ne relèvent-ils pas plutôt de la vision déformée qu’impose l’idéologie d’un ordre social théocratique plus propre à servir, en définitive, les intérêts de Satan que ceux du vrai Dieu? (Lire la suite, septième article)
N. B. Cette série d’articles est tirée de Pour discerner l’action de l’Esprit, publié en 1998 aux Éditions Spirimédia.