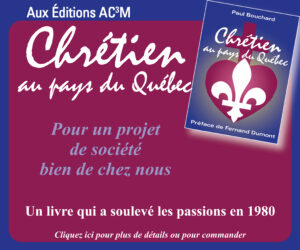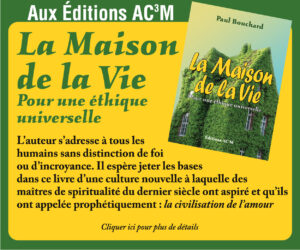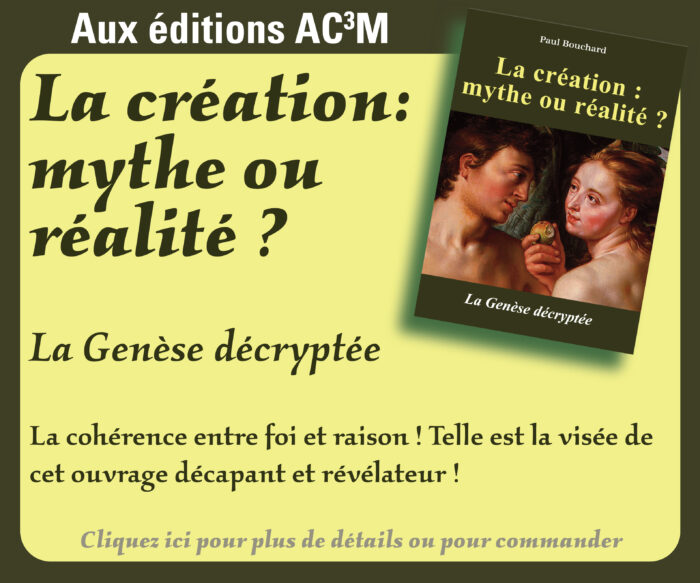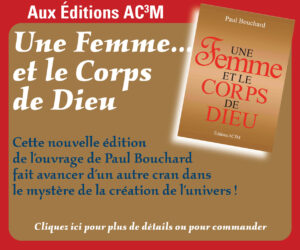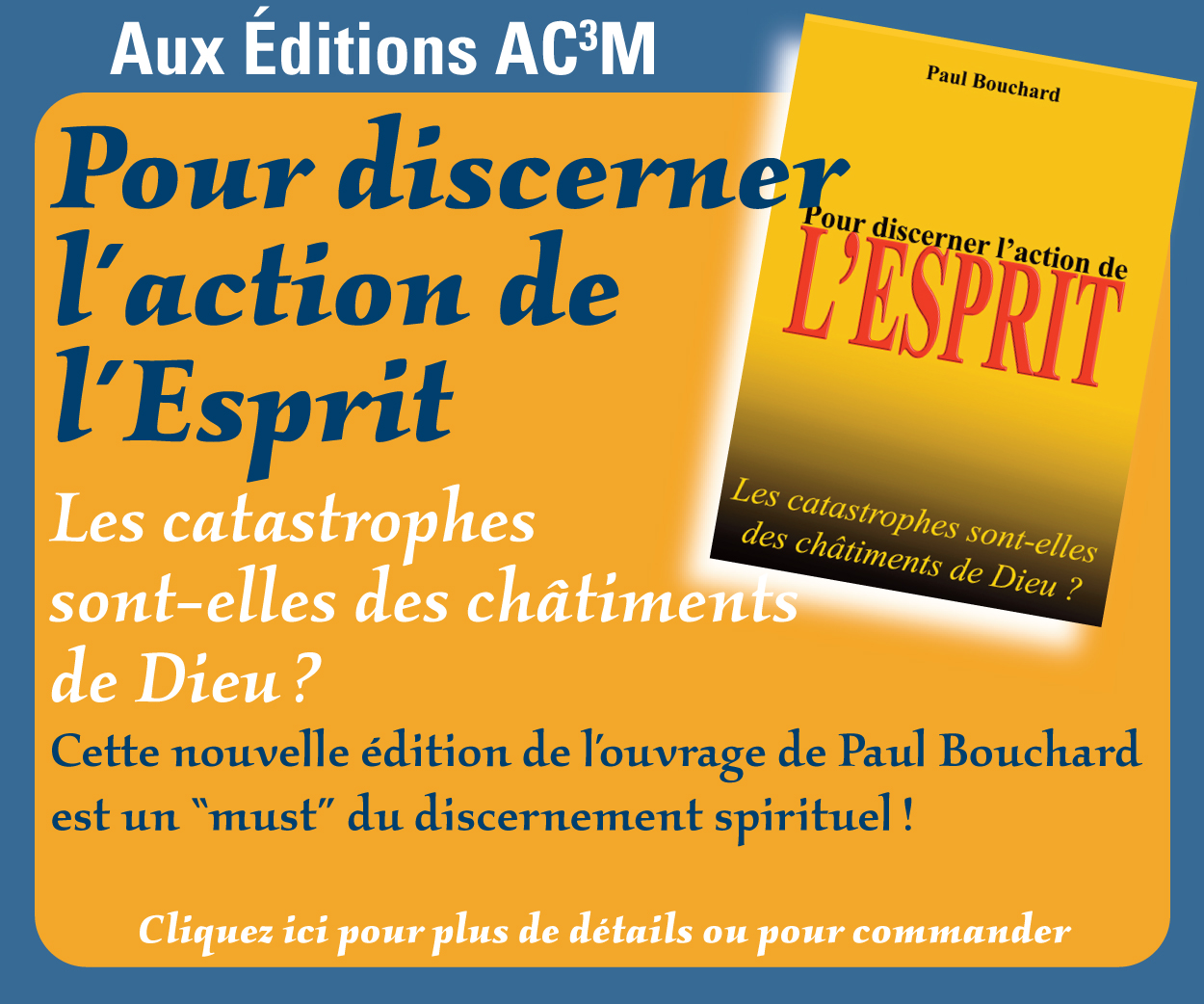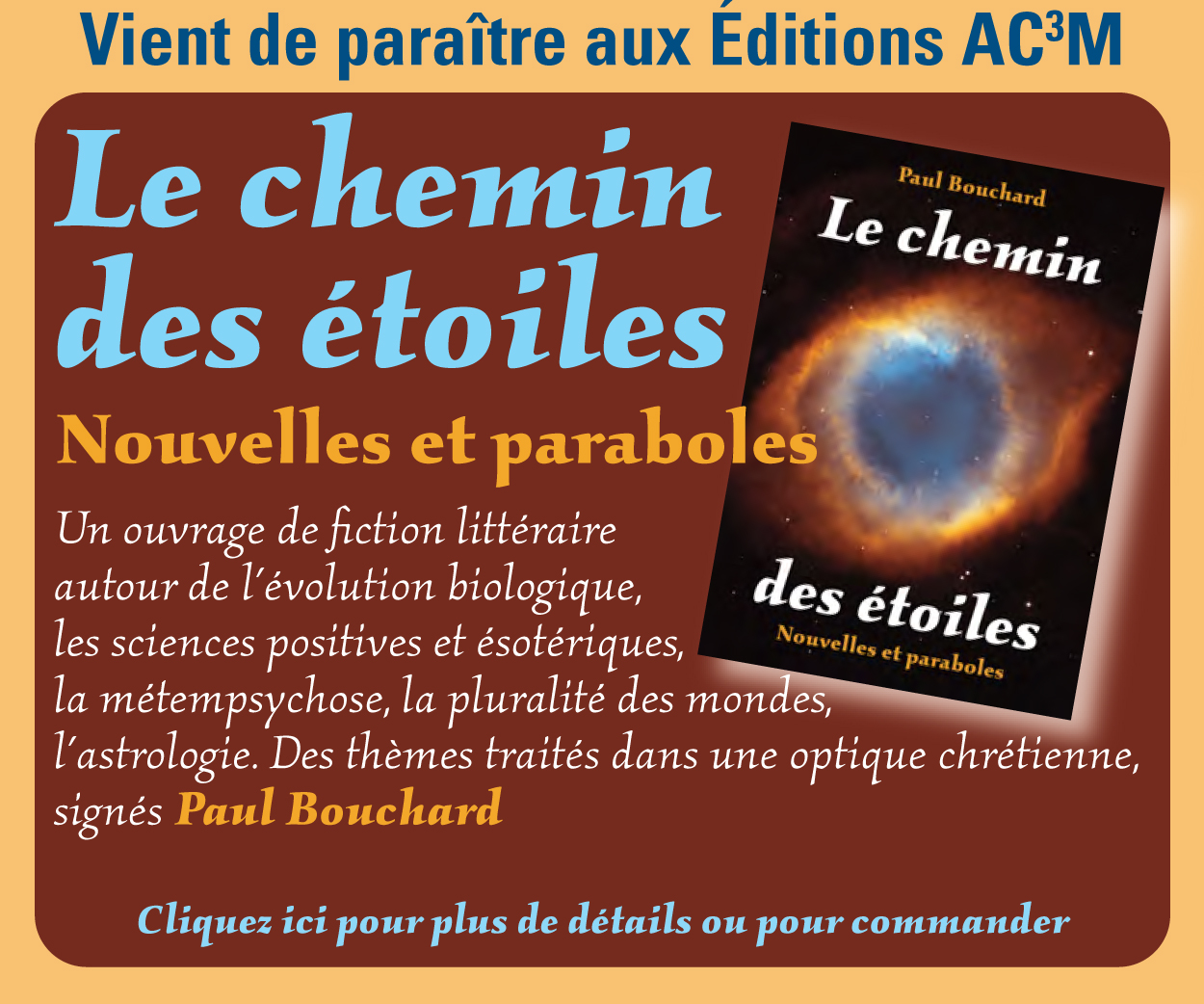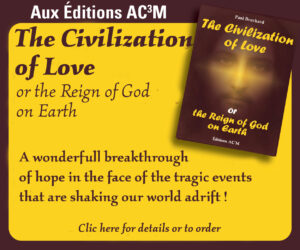Toute quête du sens de textes anciens ne va pas sans quelques a priori. Des présupposés qu’il importe de bien identifier et contrôler. Au départ, l’intention – consciente ou non – sous-jacente à la démarche d’interprétation du chercheur est décisive. Particulièrement ici, puisqu’il s’agit de scruter les deux récits de la création de la Genèse.
Car l’Écriture sainte interpelle la subjectivité du lecteur, tandis que le sens véritable du texte sacré demeure fermé à une approche strictement objective. La raison en est que la Parole de Dieu a été écrite pour la croissance spirituelle du croyant et non pour informer sur les réalités matérielles dans lesquelles les humains sont plongés. Elle vise à toucher l’intériorité des personnes et non à transmettre un savoir concerné par le côté extérieur de la réalité.
La foi
Cette précision est fondamentale. Elle conditionne le discernement. Il en découle l’exigence d’une ouverture préalable au message divin des Écritures. Parallèlement, il en ressort l’incompétence d’une approche incroyante, caractérisée par une fermeture à toute forme de Transcendance. Une foi vivante est requise pour accéder à la couche profonde des écrits inspirés de la Bible. C’est à cette condition que la Parole divine peut jouer son rôle de susciter un élargissement de la conscience du lecteur et être un agent provocateur d’évolution de la vie intérieure du croyant.
La foi en la Révélation est donc une disposition prioritaire pour une interprétation conforme au sens véritable des écrits bibliques. Je ne saurais trop insister sur l’importance de cette approche à une époque où l’on ne jure très souvent que par la matérialité objective et déclasse ce qui a trait à la subjectivité, conséquemment à la vie spirituelle des personnes.
La culture
Cette observation nous amène sur un autre terrain qui influence considérablement la rédaction et l’interprétation des textes inspirés : la culture. Dans le présent contexte, je définirais la culture comme la somme des connaissances, conceptions, traditions, conventions sous-jacentes à la conscience des humains d’une époque donnée. Or, les évidences sociales, historiques et préhistoriques démontrent une évolution dans l’humanité reliée à l’acquisition des connaissances et des valeurs de civilisation. Ce progrès culturel joue un rôle de premier plan pour une juste appréciation d’un texte issu de cultures antiques.
Si le croyant n’hésite pas à considérer l’Esprit saint comme le véritable auteur des écrits bibliques, il doit aussi du même souffle reconnaître que le Verbe divin passe inévitablement par la culture du rédacteur pour communiquer Son message. Ce qui impose à l’interprète un certain travail de décryptage des notions culturelles du scribe pour accéder au niveau de son inspiration, un peu comme le joaillier doit dégainer le diamant de sa gangue pour en révéler l’éclat. Une opération qui suppose d’autre part une distance considérable entre la culture du rédacteur et celle de l’interprète. Ce dernier devra traduire à son tour, dans les mots de sa propre culture, les notions spirituelles qu’il dégage finalement du texte médité afin que la Parole divine puisse être saisie dans sa profondeur par ses contemporains.
L’impact de la culture sur l’écrit biblique comporte donc deux volets d’une égale importance : celui du rédacteur originel et celui du commentateur contemporain ! L’on doit toutefois comprendre que les deux protagonistes n’épuisent pas la Parole divine. Ils ne parviennent pas à circonscrire en une formule parfaite le sens universel voilé sous les oripeaux de leur culture respective. Conséquemment, ils ne bénéficient pas de l’attribut d’inerrance (sans erreur) réservé à l’Écriture Sainte. L’un et l’autre sont faillibles et peuvent errer. Ce qu’ils parviennent à exprimer avec la meilleure volonté du monde est par nature bien gauche comparativement à l’intuition inarticulée qui les motive et qui, elle, est sans erreur.
Le processus d’écriture
Un tel décalage entre les réalités spirituelles et les mots qui les expriment touche particulièrement le scribe biblique en raison des outils limités d’expression culturelle dont il disposait lors de sa rédaction. Pour traduire l’impulsion spirituelle qui le sollicitait, il n’avait pas d’autre option que d’exposer, dans les limites des conceptions issues de son milieu, ce que l’Esprit saint a voulu communiquer par son entremise à l’humanité de tous les temps.
D’autre part, l’écrivain ne pouvait pas soupçonner que son récit participerait à l’œuvre colossale que l’ensemble biblique a constituée au fil des siècles. Non plus deviner que le but humain qu’il poursuivait en écrivant prendrait pleinement son sens en synergie avec les autres écrits inspirés. Car c’est parfois à son insu que le scribe a pu servir de courroie de transmission de la Parole divine. Son texte, d’ailleurs, aura pu être réinterprété et augmenté par un ou plusieurs écrivains, inspirés par l’Esprit eux aussi, pour ensuite être colligé dans la collection des livres bibliques finalement accrédités comme tels par les cadres religieux plusieurs siècles après leur rédaction.
Le processus littéraire qui a généré la Bible a de quoi étonner. Il manifeste une cohérence qu’aucun humain isolé n’aurait pu concevoir, aucune culture planifier. Comment des livres de styles et de sujets très variés, rédigés sur plusieurs siècles et provenant de divers milieux ont-ils pu se retrouver sous le couvert de la Bible ? Comment expliquer l’unité de pensée de cette écriture sinon par son Auteur d’outre espace et temps ? Car c’est précisément au-delà des cultures, des styles littéraires, des intentions conscientes ou non des auteurs et des divers milieux sociaux, que Dieu a proclamé Sa Parole.
Quelle est la teneur de cette manifestation ? Comment Dieu parle-t-il ? Prenons note ici d’une nuance très significative !
En parlant de la Bible, nous ne disons pas “les Paroles de Dieu” au pluriel mais LA Parole au singulier. Ce n’est pas parce qu’ici et là on y retrouve des paroles attribuées à Yahvé qu’on qualifie la Bible de Parole de Dieu. Non plus parce que certains passages sont particulièrement édifiants ou font état d’un code moral. La Bible est Parole de Dieu globalement, dans son ensemble, en tant qu’entité, parce que le Seigneur, selon notre foi, s’y est manifesté et s’y manifeste encore aujourd’hui par son Esprit.
Le langage de Dieu est transcendant. Sa Parole s’élabore au-delà des mots que les humains utilisent pour traduire leur pensée ou exprimer l’inspiration de l’Esprit. Lorsque Dieu parle à l’humanité, ses mots à lui s’étalent sur des siècles. Ils englobent des événements, font intervenir des peuples et mettent en scène le déroulement de l’histoire. Ainsi, chaque livre, chaque passage de la Bible se rapportent à un tout dont l’ensemble forme la Parole divine. Il est donc impossible d’interpréter correctement le sens d’un passage isolé sans l’éclairer par l’ensemble.
L’interprétation
Cette complexité du processus littéraire de la Bible fait ressortir, entre autres, l’incompétence d’une lecture fondamentaliste. Car le simplisme de l’acception littérale peut ne pas rendre compte adéquatement de la Vérité révélée par l’ensemble du texte sacré. L’attachement excessif à la lettre prédispose plutôt à l’aveuglement du fanatisme. «La lettre tue, l’Esprit vivifie» (2 Co 3, 6), avertit saint Paul. Le littéralisme est d’ailleurs mis en échec dès les premières pages de la Bible par les contradictions apparentes (cf. L’évolution de l’Alpha à l’Oméga, édition AC3M, page 27 +) inhérentes aux deux récits de la création.
On peut noter ici que l’évolution de la civilisation depuis l’Antiquité, en élargissant et en multipliant les perspectives, confère au point de vue contemporain un net avantage. Le développement de l’archéologie, de la paléontologie, de la génétique, de l’histoire, de l’exégèse, de l’herméneutique, de la linguistique, de la théologie, de l’éthique, etc., permet de poser un regard sans précédent sur le texte biblique en débroussaillant les zones périphériques de sa création. Il faut toutefois reconnaître que si les sciences peuvent contribuer à l’éclairage du contexte de création des Saintes Écritures, elles ne permettent pas, en raison de leur approche strictement objective, de puiser à la Source divine du texte que seule la subjectivité éclairée par l’Esprit peut apprécier.
C’est à cette profondeur que j’espère descendre dans cette étude. Sans prétention. Je ne vise pas à faire œuvre scientifique. Je n’ai pas l’intention de recourir, sinon en passant, aux données les plus récentes de la recherche. Il y a d’abord que je ne dispose d’aucune compétence dans l’une ou l’autre discipline concernée. De plus, comme on peut le déduire de ce qui précède, une analyse à partir de données d’érudition ne donnerait pas le résultat espéré. Car toute spécialité scientifique ne couvre toujours qu’une tranche de la réalité, de sorte que l’exposition globale du réel demeure hors du champ des experts. À examiner de près une partie, le tout échappe à l’observateur. «L’arbre cache la forêt», dit-on pour illustrer cette limite de la quête de connaissances objectives.
La méthode
Mon optique est la plus générale possible. C’est celle du philosophe qui se confronte candidement à toute la réalité par la logique rationnelle et, dans ce cas particulier, sous l’éclairage de la foi en Dieu. La méthode que je compte appliquer à cette démarche m’a été suggérée par Jean-Paul II. Dans un discours adressé à une assemblée constituée de scientifiques, de philosophes, de théologiens, le pape a précisé certains critères pour une juste interprétation de l’Écriture.
Pour ma part, en recevant le 31 octobre 1992 les participants à l’Assemblée plénière de votre Académie, j’ai eu l’occasion, à propos de Galilée, d’attirer l’attention sur la nécessité, pour l’interprétation correcte de la parole inspirée, d’une herméneutique rigoureuse. Il convient de bien délimiter le sens propre de l’Écriture en écartant des interprétations indues qui lui font dire ce qu’il n’est pas dans son intention de dire (Jean-Paul II, Discours à l’Académie pontificale des sciences, 1996).
Que doit-on entendre par ces «interprétations indues» à “écarter” et qui font dire à l’Écriture «ce qu’il n’est pas dans son intention de dire» ?
Au cours des siècles, l’Église a pu associer au texte biblique des interprétations issues en fait de préjugés culturels ou de spéculations inspirées par des systèmes de pensée extrabibliques qui ont eu d’indéniables répercussions sur sa tradition théologique et catéchétique. Un amalgame superficiel entre ce que l’humain d’une culture donnée perçoit de la réalité et la Révélation biblique.
La condamnation par le Magistère sous le pape Paul V en 1616 de la cosmogonie héliocentrique du chanoine Nicolas Copernic comme «contraire aux Écritures» est un exemple patent de cette confusion. Le procès intenté quelques années plus tard pour la même raison par l’Inquisition contre Galilée (1633), entérinait ce jugement erroné, à savoir que l’opinion scientifique estimant que notre planète gravite autour du soleil était incompatible avec la vérité révélée de la Bible.
Cependant, on chercherait en vain dans la Bible un passage qui aurait pu être utilisé pour contredire clairement les thèses de Galilée et de son savant prédécesseur. Certes, plusieurs versets poétiques, tirés des psaumes entre autres, évoquent la course du soleil, de son lever à son coucher. Ce sont là toutefois des expressions populaires basées sur l’apparence qui n’imposent absolument pas une cosmogonie particulière. On utilise encore aujourd’hui ces images, même si tout le monde sait que c’est la terre qui tourne et non le soleil qui se déplace.
Les préjugés de l’Inquisition, en fait, n’étaient pas fondés sur l’Écriture mais bien sur des éléments de culture scientifiques qui remontaient à l’Antiquité grecque. Les conceptions du temps s’appuyaient sur la cosmogonie de Ptolémée, un savant grec qui, au premier siècle de notre ère, avait démontré par de complexes calculs que notre planète, sise fixement au centre de l’univers, était entourée par neuf “ciels”, des sphères translucides correspondant aux diverses trajectoires des planètes et des astres. Les spéculations philosophico-théologiques du Moyen-âge rajoutaient à cette cosmogonie imaginaire l’idée d’un Moteur divin qui actionnait ultimement une mécanique céleste – régulée par les anges – en rotation autour de la terre.
Les psaumes de la Bible présentent en fait une tout autre conception du cosmos. Le psalmiste croyait que notre planète était ancrée dans les eaux de l’océan. Il comparait la voûte des cieux à une tente dont les trous minuscules laissaient filtrer la lumière des étoiles. L’on croyait alors que la terre avait la forme d’un disque limité par les mers et reposait stablement sur quatre piliers correspondant aux quatre points cardinaux.
Au Seigneur, les colonnes de la terre : sur elles il a posé le monde (1 S 2, 8).
Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers, et la tient stable sur les flots (Ps 24, 1-2).
Tu déploies les cieux comme une tente…
Tu poses la terre sur ses bases,
inébranlable pour les siècles des siècles.
De l’abîme tu la couvres comme d’un vêtement » (Ps 104, 2.5.6).
À l’époque de Copernic et de Galilée, ces conceptions bibliques étaient largement déclassées par les cosmogonies de l’Antiquité, notamment celle d’Aristote. Les prélats de l’Inquisition n’en tenaient pas compte. Les jugements qu’ils ont émis au nom de la vérité biblique ne pouvaient donc pas du tout se justifier par l’Écriture.
À la suite des développements scientifiques contemporains, on pourrait estimer risibles ces conceptions s’ils n’avaient pas été la cause d’une grave erreur de jugement du Magistère. Une faute historique qui a non seulement blessé de nobles et valeureux croyants – les initiateurs de l’ère scientifique moderne – mais a marqué l’Église pendant des siècles d’un stigmate de défiance des sciences, entraînant une portion importante de fidèles dans un combat obscurantiste contre le progrès social et l’évolution culturelle de l’humanité.
C’est là une déviation que Jean-Paul II exhorte à éviter en épurant notre lecture des «interprétations indues qui lui font dire ce qu’il n’est pas dans son intention de dire». Une instrumentalisation déformante et abusive de l’Écriture dont les effets ont pu même se répercuter jusque dans certains énoncés théologiques et catéchétiques véhiculés par la Tradition.
Dans ce travail – auquel j’invite le lecteur à participer par ses commentaires, ses connaissances et son érudition lors de la publication par tranches sur l’Internet –, nous devrons parfois considérer quelques-uns de ces énoncés avec un œil critique pour parvenir à poser un regard neuf, exempt de préjugés, sur le texte biblique. Il s’agit, dans un deuxième temps, d’appliquer à notre lecture une «herméneutique rigoureuse… pour l’interprétation correcte de la parole inspirée». Ce qui pourra se faire si nous nous mettons à l’écoute du rédacteur biblique et adressons notre questionnement à sa logique, épurée de l’artifice des extrapolations séculaires. Pour paraphraser positivement Jean-Paul II, il s’agit de saisir, avec l’aide de l’Esprit et dans le cadre de notre propre culture, ce que l’Écriture a eu l’intention de dire par le truchement du récit de l’auteur.
Nous n’avons rien à craindre d’une telle approche, car «la vérité ne peut pas contredire la vérité». Jean-Paul II faisait écho à cette formulation lapidaire de Léon XIII (Lettre encyclique Providentissimus Deus) à l’occasion d’un discours adressé à des professeurs et à des étudiants de Cologne.
Il ne peut y avoir de conflit fondamental entre la raison qui, en conformité avec sa propre nature qui vient de Dieu, est axée sur la vérité et est ordonnée à la connaissance de la vérité, et une foi, qui réfère à cette même source divine de toutes les vérités. La foi confirme en fait les droits spécifiques de la raison naturelle» (5 novembre 1980).
Lors d’un symposium organisé par l’Académie pontificale des sciences et le Conseil pontifical pour la culture, Jean-Paul II revenait sur ce thème.
Lorsqu’elles suivent leurs propres méthodes respectives, la religion et la science sont des éléments constitutifs de la culture… et plutôt que de s’opposer, elles sont marquées par la complémentarité » (4 octobre 1991).
Tant et si bien que s’il pouvait se trouver des incohérences apparemment insolubles – ce que je ne crois pas – entre les connaissances objectives et des interprétations traditionnelles de la Parole de Dieu, il faudrait alors questionner l’interprétation plutôt que de rejeter la vérité démontrée par la raison. Car bien comprise, «la foi confirme en fait les droits spécifiques de la raison naturelle». Et l’ordre par lequel «la vérité tout entière» (Jn 16, 13) est acquise commence par le questionnement de la raison. Puis, dans l’axe du dépassement de la faculté rationnelle mais en toute cohérence avec elle, surgit l’éclairage de la foi.
Cliquer sur le lien pour accéder à l’article suivant : «Au commencement…».